Séance n°3, mercredi 3 février 2021. Propos recueilli par Aida Abbou, Coline Bouvet et Andrés Cobos, relu par Sophie Fétro.
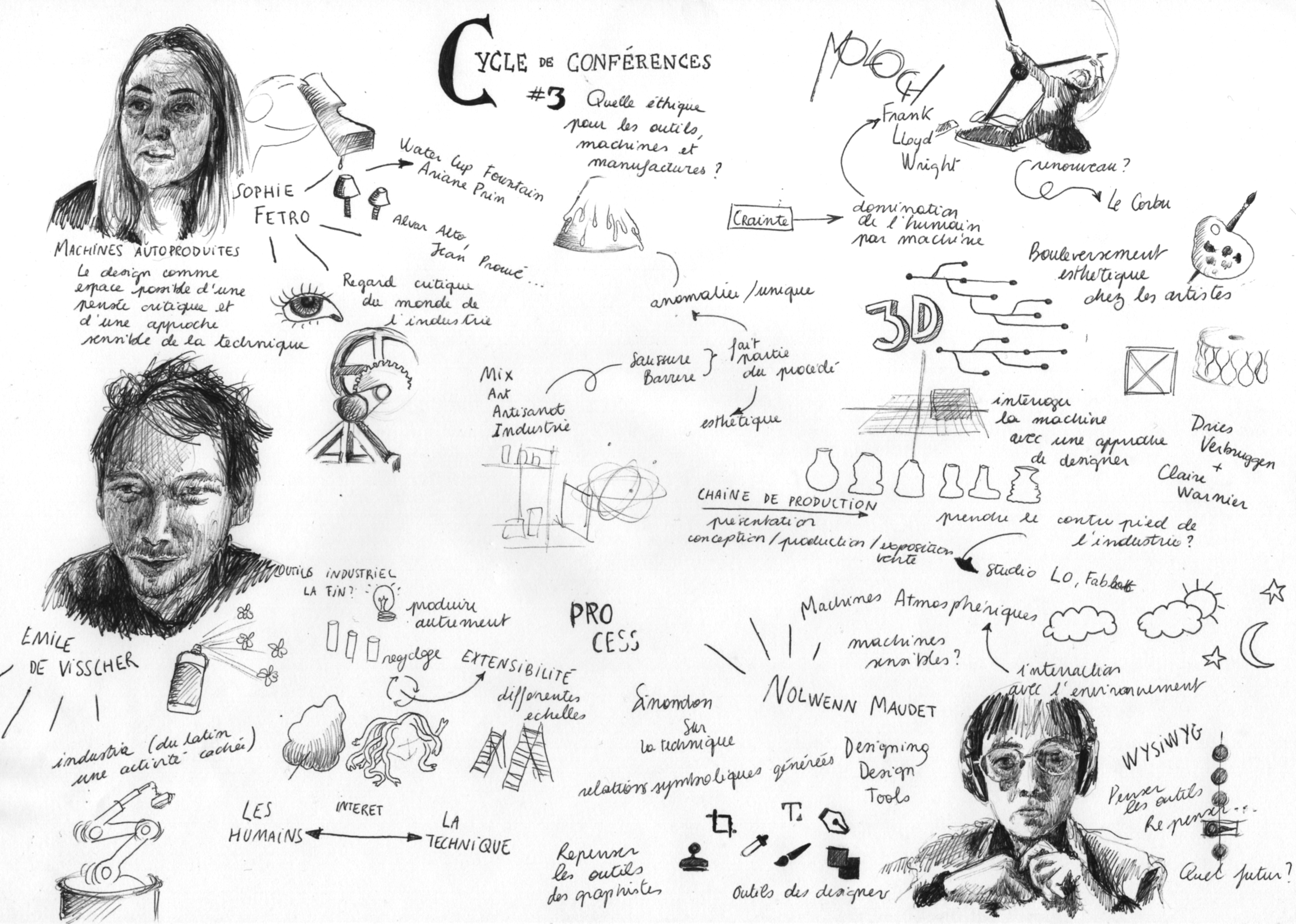
Figure 1. Synthèse graphique 3, Lucy Doherty
Podcast 3
1. Conférence de Sophie Fétro : Machines autoproduites, le design comme espace possible d'une pensée critique et d'une approche sensible de la technique.
Je vais d'abord commencer par te remercier, Catherine, de m'avoir invitée à ce séminaire. Je suis ravie de participer à cette session-là, évidemment en distanciel. Mais bon, le sujet étant les machines, on est finalement dans le cœur du sujet et du dispositif. Et puis je suis contente de partager cette séance avec Émile de Visscher et Nolwenn Maudet. Aussi, je te remercie chaleureusement pour cette invitation. Pour ma part, j'ai intitulé ma présentation Machines autoproduites, le design comme espace possible d'une pensée critique et d'une approche sensible de la technique.*
1.1 Présentation des questionnements
Je vais commencer par vous montrer un certain nombre d'exemples, de références visuelles et je m'intéresserai à des situations singulières qui conduisent finalement les designers à fabriquer et à mettre au point leurs propres machines de production. Généralement, on situe bien souvent le design en amont du faire et de la fabrique, du côté plutôt de la conception d'un disegno en tant que manifestation, d'un concept, d'une idée. Mais bien évidemment, ce n'est pas que cela. Il s'avère en réalité génératif aussi de formes sensibles, d'expériences, d'objets techniques, de tests, d'objets intermédiaires. Et nombreux sont les designers, notamment des designers reconnus qui se sont intéressés à la fabrique et ont installé une proximité avec l'industrie au sens large du terme.
Que l'on pense bien évidemment à Alvar Aalto et sa relation à l'entreprise Isokon, à Marcel Breuer et ses meubles en tube coudé, Jean Prouvé et ses ateliers de Maxéville, voire même Gaetano Pesce avec ces objets en résine. Je vais donc vous proposer de nous intéresser à trois orientations spécifiques concernant la relation possible du design à la machine, lorsque, précisément, les designers se mettent à concevoir et réaliser leurs propres outils de production. Nous aborderons, d'une part, les rapports qu'entretiennent ces machines autoproduites par les designers avec l'artisanat. Deuxième point, il sera plutôt question de la relation de ces machines à l'industrie. Et troisièmement, la relation de ces machines au milieu.
Voilà trois orientations pour vous présenter le cadre général de la présentation de ce soir. Je prendrai pour chacune de ces trois orientations, un ou deux exemples qui me serviront de fil directeur et de point de départ à la réflexion afin de mettre en évidence des enjeux ou problématiques qui mettent en jeu le design, l'industrie et l'art dans leurs modalités productives. Les trois orientations que j'ai choisies vont, chacune à leur façon, prendre le contrepoint d'une idée reçue à l'égard du design, mais aussi serviront à aborder la position de chaque designer évoqué à partir de ce qu'ils inventent et génèrent. Je voudrais en particulier faire le lien avec la thématique de ce soir et montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un positionnement éthique, au sens moral du terme, mais plutôt de positions critiques à l'égard de l'industrie, en particulier de la grande industrie. C'est en tout cas cette façon de faire exister plusieurs voix et non un unisson qui m'intéresse ici et qui sera au cœur de ma présentation de ce soir.
1.2 La production artisanale des machines
Le premier point que je voudrais aborder concerne la relation du design à une production artisanale de machines. Tandis que l'on associe souvent l'artisanat au seul fait main, on oublie largement que l'artisan travaille avec des outils, mais aussi avec des machines, qu'il les fabrique parfois, qu'il peut en détourner leurs usages habituels et qu'il peut aussi les ajuster à ce qu'il veut produire. La première machine que je vais donc aborder est donc volontairement ambivalente, à la fois tout à fait artisanale dans ses moyens, car autoproduite par une artiste/designer et en même temps capable de produire des petites séries. Il s'agit ici de la Water Cup Fountain d'Ariane Prin, qui est une machine à céramique qu'elle a intitulée Dripper, littéralement goûteur en français. Ce dispositif est particulièrement intéressant, car il emprunte à la fois à l'artisanat, au regard des pièces uniques qu'il engendre, à la manufacture car la main n'est pas exclue du processus, ainsi qu'à l'industrie au regard du processus sériel qui est mis ici en place. Cette machine qu'elle crée en 2012 à l'occasion d'une résidence au Design Centrum de Kielce (DCK) en Pologne permet de créer des gobelets en porcelaine : « Quatre contenants en céramiques [...] versent sur 16 moules en plâtre tournant en dessous, de la porcelaine liquide, créant ainsi couche après couche des verres aux motifs aléatoires uniques1 » tels des sortes de drippings tridimensionnels.
Sur le plan de la conception, cette machine a fait l'objet d'un processus de conception qui passe par le dessin, la modélisation 3D, des tests de dépôts de matière qu'on voit ici, une phase de prototypage, jusqu'à la fabrication de la machine elle-même qu'on voit ici, mise à nu. Cette machine s'inscrit dans une lignée et une typologie de machines identifiées que l'on appelle dans l'histoire des techniques des « machines simples2 », dans le sens où le dispositif mécanique est relativement élémentaire. Disons qu'il se donne à comprendre assez facilement, impliquant un mouvement circulaire (la base du plateau tourne) ainsi que des pivotements sur plusieurs axes pour faire couler la matière. Dans l'histoire des techniques, les machines simples sont des dispositifs élémentaires comme le levier, les roues crantées, la vis sans fin d'Archimède, mais aussi des mécaniques un peu plus élaborées comme les machines d'Alexandrie ou les machines de la Renaissance, celles de Léonard de Vinci ou, par exemple, cette roue de lecture imaginée par Agostino Ramelli en 1588. Pour autant que l'on puisse qualifier la machine d'Ariane Prin de simple, mécaniquement parlant, elle s'avère en réalité plus complexe qu'il n'y paraît au regard des enjeux qu'elle interroge aujourd'hui, tant sur le plan des modes de production que politiquement, symboliquement et artistiquement. En effet, une dimension symbolique vient s'adjoindre à sa démarche en lien avec l'histoire de la ville et de la prison dans laquelle elle expose sa machine (en place jusqu'en 1956), « témoin silencieuse de la torture de nombreux combattants de la liberté polonaise ». Cette machine rend donc en quelque sorte hommage au « sang de ces victimes, torturées par l'eau, avant d'être tuée devant le mur des exécutions ».
Elle indique par ailleurs dans son site web3 que l'inspiration pour ce travail provient également du rassemblement spontané des habitants de Kielce autour de nombreuses fontaines de la ville et de leurs interactions joyeuses avec l'eau pendant la période estivale. Outre les références qu'elle cite, ce dispositif et les objets qui en résultent ne sont pas sans lien avec un type d'aménagement paysager particulier, caractéristique de l'esprit baroque, celui des grottes artificielles au XVIIe et XVIIIe siècle. Certaines grottes baroques sont particulièrement remarquables, car elles sont accompagnées de machines surprenantes, sortes de dispositifs techniques ingénieux qui permettent la mise en mouvement de présences mobiles : on voit à travers cette gravure une sorte de manège faisant tourner des nymphes, Neptune et d'autres êtres aquatiques. Les planches sont extraites de l'ouvrage de Salomon de Caus qui s'intitule Les raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utiles que plaisantes, où figurent plusieurs dessins de grottes et fontaines. Salomon de Caus est un personnage singulier, à la fois ingénieur et architecte français de la Renaissance, mathématicien, mais aussi artiste et poète qui a vécu entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII. À cette époque, les sciences et les arts ne sont pas opposés. La mécanique relève d'un certain art du spectacle non seulement parce qu'elle sert à des fins de divertissement comme ici, mais aussi parce qu'elle implique un certain type de représentation. Et ce point est à relever tout particulièrement. En effet, ces gravures nous montrent que le plaisir tient autant dans l'illusion que ces dispositifs mettent en place, faisant croire à l'apparition d'êtres surnaturels que dans le fait de révéler les tours techniques qui sont en jeu à travers ces dispositifs.
C'est d'ailleurs ce que souligne Jean-Pierre Séris dans son ouvrage Machine et communication. Du théâtre des machines à la mécanique industrielle, à travers ce qui est appelé au XVIIe siècle des « théâtres » qui sont en réalité non pas des représentations dramatiques, mais des recueils illustrés, qui avaient vocation à exposer la nature, par exemple, ou, comme ici, des tours mécaniques mettant en place ce qu'il nomme une « didactique illustrée ». Pour l'anecdote, c'est vraisemblablement à Salomon de Caus, à qui l'on doit l'invention de la ligne ponctuée, qui sont en fait des lignes discontinues qui permettent dans la représentation graphique de montrer ce qui n'est pas visible à l'œil nu; ce que l'on appelle plus communément aujourd'hui des pointillés,
Le théâtre de machines est un recueil graphique visuel qui revêtait une dimension démonstrative et spectaculaire, au sens premier du terme, autrement dit qui consistait à exposer, offrir au regard de celui qui le consultait, le fonctionnement de machines, permettant ainsi d'accéder à leurs mystères. On le voit ici dans cette planche qui est scindée en deux avec, dans la partie à droite, la scène baroque de la grotte où se déroule le spectacle de façon visible et, à gauche, la machine et les coulisses du spectacle.
Jean-Pierre Séris dira : « par ce coup d'œil audacieux sur les procédures de la dissimulation, le théâtre atteint une perspective limite qui le conduit à mettre en scène et dénoncer le mécanisme de l'illusion4». Au fond, on peut faire l'hypothèse qu'Ariane Prin, avec sa machine, actualise quelque chose qui était manifeste au XVIIe siècle à travers la conception et la production de machines tant utiles que plaisantes, et qui, peut-être, s'est un peu étiolé par la suite.
Sa machine rejoint un des traits distinctifs de la science baroque dont l'essence, dit Herbert H. Knecht, peut être résumée par le terme de curiosité qui ne renvoie ni à un « rationnel exacerbé » ni une « orthodoxie mécaniste », mais à un autre thème baroque : « la cohérence des opposés5 ». À la différence toutefois des virtuosi baroques, la mission récréative n'est pas première chez Ariane Prin. Sa mêkhanế («invention ingénieuse, dispositif ») n'est pas non plus une récréation mathématique, elle revêt une dimension critique et potentiellement dénonciatrice. Telle pourrait être l'hypothèse que l'on peut faire ici : celle d'engager un travail de suture opérant « l'unité du rationnel et du merveilleux», une convergence de la technique et de l'art, travail qui serait précisément le propre du design, selon Vilém Flusser.
Cette scission de l'art et de la technique, la machine d'Ariane Prin semble donc la contester et tenter une convergence des deux. Il y a en effet dans la démarche d'Ariane Prin, cette volonté d'en découdre avec les cadres établis. De même que l'art baroque qui a pu être pensé comme une contestation de la régularité de la renaissance et du classicisme, la proposition d'Ariane Prin «signale - comme le propose la philosophe et artiste Anne Sauvagnargues - un intérêt pour les anamorphoses de la forme6». « C'est en cela que le baroque pose de manière kantienne le problème de la production d'une nouvelle règle, d'une originalité d'abord incapable d'être reçue parce qu'elle choque le goût, d'une originalité qui n'est pas encore devenue exemplaire7.» Alors que la salissure, la bavure, est généralement supprimée dans le modèle industriel, ici, elles participent de la logique productive et de l'esthétique même des formes produites. A contrario d'une production industrielle qui a tendance à privilégier le lisse, ces rugosités nous parlent d'une esthétique et d'une fabrique capable d'intégrer une forme d'anomalie, si on fait référence à Canguilhem, comme possibilité esthétique et terrain d'exploration ouvert à la pluralité.
1.3 La relation des machines autoproduites à l'industrie
Le deuxième point que je veux aborder ici concerne la relation de l'être humain à la machine et l'idée qu'au fond, la machine serait la cause des maux du monde moderne. Il plane en effet au-dessus des machines, une méfiance légitime à leur encontre qui s'exprime à travers la crainte d'une inversion du rapport de domination qu'exerce l'être humain sur elle. L'époque moderne est d'ailleurs traversée par le mythe de cette inversion et le designer, lorsqu'il produit une machine, s'inscrit, qu'il le veuille ou non, dans cette histoire culturelle du mythe de l'aliénation possible de l'être humain par la machine.
Des designers et architectes, théoriciens du design ont aussi témoigné de ce rapport inquiet au machinisme conquérant. C'est le cas de Frank Lloyd Wright qui, dans un article intitulé «In The Cause of Architecture: The Architect and the Machine » qui date de 1927, tient les propos suivants: « La Machine est un moteur d'émancipation ou d'asservissement, selon la direction et le contrôle que l'homme lui donne, car elle est incapable de se contrôler elle-même. Il n'y a pas de volonté d'initiative dans les machines. L'homme est toujours derrière le monstre qu'il a créé. Le monstre est impuissant envers lui-même. J'ai dit "monstre" - et non "sauveur" ? Parce que la Machine n'est pas meilleure que l'esprit qui la conduit ou la fait fonctionner et l'arrête. [...] Cela sera évident pour quiconque s'arrêtera pour étudier le Moloch mécaniste moderne et prendra le temps de le voir dans ses aspects les plus larges8. » Pour information nous nous situons, avec cet extrait, avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui montre que cette inquiétude, est au fond, ancienne.
Frank Lloyd-Wright rappelle ici que la machine n'est pas en soi asservissante. La cause du problème n'est finalement pas la machine elle-même, mais l'être humain qui s'avère être le véritable décideur, celui qui détermine ce qu'il en fait. Par conséquent, si la machine « prend le pouvoir9 » pour paraphraser le titre de l'ouvrage de Siegfried Giedion, c'est qu'au fond, un être humain intéressé a décidé de la pousser dans ce sens.
Un autre théoricien, Lewis Mumford, historien et théoricien américain, spécialisé dans l'histoire de la technologie et de la science et de l'urbanisme, qui a d'ailleurs eu une correspondance régulière avec l'architecte F. L. Wright, a développé, quant à lui, un concept singulier, celui de « mégamachine10 », qui désigne un système d'organisation global et autoritaire qui conduit à une subordination de l'être humain vis à vis d'une instance supérieure dominante. Le propre de la mégamachine est de subjuguer, imposant un rapport dominant à celui qu'elle met sous son joug. Contrairement à Jean-Pierre Séris ou Flusser, Lewis Mumford situe historiquement l'avènement de la mégamachine, non pas au XIXe siècle, qui serait le siècle de l'industrie triomphante, non pas avec ses prémisses au tournant du XVIIe et XVIIIe siècle, mais en amont, dès l'Antiquité romaine et égyptienne, notamment.
L'idée de ce rapport de force entre l'être humain et la machine va être magistralement incarnée dans le film de Fritz Lang, Metropolis où la machine souterraine, celle qui fait fonctionner la ville moderne va surchauffer, s'emballer jusqu'à se transformer en un véritable monstre. Le « moloch » (terme que l'on retrouve dans les propos de Frank Lloyd Wright) qui renvoie à une divinité et à un culte sacrificiel d'enfants s'impose à l'être humain et finit par le dominer. Dans une version beaucoup plus dramatique que dans Les temps modernes de Chaplin, l'être humain n'arrive plus à suivre et ne parvient plus à répondre finalement à la cadence imposée par la machine. Cette dernière s'emballe jusqu'à l'implosion se transformant en une divinité maléfique, qui, la gueule ouverte, avale les ouvriers dociles devenus impuissants. Cette crainte de la domination du corps et de l'esprit humain par la machine se retrouve aujourd'hui exacerbée par la puissance de calcul informatique et l'automatisation algorithmique des procédures qui empêchent d'agir véritablement et directement sur elles.
Toutefois, bien que la machine, puisse renvoyer, dès la tradition grecque, au piège, au stratagème, à la machination malveillante dont il faut se déprendre (Detienne et Vernant), la machine a aussi largement emporté l'adhésion et suscité l'attention des artistes, architectes et designers. Ceci constitue un nœud problématique, qui éveille chez l'individu un sentiment ambivalent de répulsion et d'attirance envers les machines.
Le Corbusier pose en 1925, deux ans avant le petit texte que je vous ai lu de Wright dans un texte qui s'intitule La leçon de la machine, une question qui, à mon sens, est encore d'actualité aujourd'hui : « est-ce qu'un bouleversement esthétique surgirait?» La question se pose avec d'autant plus d'à propos que les expositions universelles relaient le développement machiniste participant en quelque sorte d'un choc esthétique. Pour Le Corbusier, la machine, à n'en pas douter, renouvelle les repères esthétiques, offrant aux sens et à la perception quelque chose d'inédit. Ainsi, la machine intrigue, fascine en raison de sa force, mais aussi au regard de son organisation et de la relation des différents éléments qui la composent en un tout inédit. La comparaison avec un corps humain ou le vivant sera fréquent dans ses textes, le conduisant à parler d'organe ou d'organicité de la machine, cultivant par le biais de la métaphore, le parallèle entre le corps biologique et le corps machinique.
L'art moderne des années 20 va ainsi largement célébrer la machine, les rouages, les turbines, les moteurs, que l'on pense au purisme de Le Corbusier et Ozenfant (1918), aux peintres comme Victor Servrancks (Opus 47. Exaltation du machinisme, 1923), Fernand Léger (Élément mécanique*, 1924), ou aux peintures des futuristes célébrant la vitesse. Voilà ce bouleversement esthétique à l'œuvre. Les artistes n'hésitant pas à le rendre manifeste.
Après la Seconde Guerre mondiale, la machine a fait naître légitimement des doutes sur le bien-fondé de la technologie et sur l'idée même de progrès corrélatif des avancées techniques et mécaniques, quant au fait que le monde s'en trouverait changé positivement. Malgré certaines craintes, l'idée de progrès, l'engouement pour les technologies et la logique machiniste et productiviste ont continué à se développer. L. Mumford nous dit à cet égard : « se révolter contre le système, douter de sa valeur morale ou tenter de s'en dégager signifiait obéir aux dieux de la puissance. Ces dieux sont encore parmi nous à peine masqués. » Aujourd'hui, le développement des high-tech, d'Internet, de la fabrication assistée par ordinateur a aussi conduit les designers, ceux-là même qui connaissent très bien l'industrie et la technique, à développer des positions critiques à l'encontre du système productif et de ses dérives.
Aussi, malgré les possibles écueils du machinisme, les designers vont continuer d'impliquer des machines dans leur production à la fois avec une sorte de conscience d'un système qui peut s'avérer problématique et, en même temps, une sorte d'engouement qui va les conduire à les solliciter autrement que sous l'angle de l'emphase ou de la recherche d'efficacité productive ou du haut rendement, contre la mégamachine identifiée et dénoncée par L. Mumford.
Dans le champ du design depuis les années 2010, les machines font l'objet d'un regain d'intérêt. Adrian Bowyer et Vic Oliver, mettent au point le projet RepRap en 2005 à l'Université de Bath au Royaume-Uni, au sein du département d'ingénierie mécanique. Pour eux, l'idée est de « mettre en place un système de production applicatif qui permette de produire une imprimante 3D en partie, auto réplicative et libre c'est-à-dire sans brevet, et dont les plans sont disponibles sous licence publique générale GNU11. » Ainsi, avec la création d'une machine « parent », ils vont pouvoir imprimer des pièces qui vont se retrouver au sein de la machine « enfant ». Leur démarche conduit à privilégier l'open source aux machines et systèmes de production propriétaires dans le but de favoriser l'accès aux moyens de production pour tout un chacun.
2005 est une date essentielle dans l'histoire du développement de l'impression 3D car, depuis, un très grand nombre d'imprimantes 3D de type reprap ont été développées. Un arbre généalogique a d'ailleurs été produit, dédié au déploiement et à l'évolution des RepRap et de leurs applications, témoignant des nombreuses variantes d'imprimantes 3D qui ont pu découler du modèle initial, entre 2006 et 2012. On s'aperçoit que leur développement a été exponentiel et que cette première machine a inspiré et initié de nombreuses autres machines après elle. Cet arbre n'a d'ailleurs cessé de croître au fil des ans, ce qui fait qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de référencer toutes les variantes qui existent.
L'invitation de Frank Lloyd Wright à « étudier le moloch mécaniste moderne et prendre le temps de le voir dans ses aspects les plus larges » semble donc ici se mettre en place de façon individuelle et collective, interrogeant l'orientation des techniques et la façon dont il est possible d'en assurer les conduites. Il est intéressant de remarquer que malgré la critique faite à l'encontre du machinisme moderne, les designers ont fait le choix de continuer à produire des machines en rendant possible une production qui prend le contre-pied des sollicitations machinistes courantes dans le champ de l'industrie dominante. C'est donc plus ou moins intuitivement que les designers se sont mis à développer leurs propres outils et machines de production, se positionnant contre le moloch mécaniste moderne, et « désobéissant aux dieux de la puissance », pour paraphraser L. Mumford.
En 2010, lorsque le collectif belge Unfold met au point L'artisanat électronique, Claire Warnier et Dries Verbruggen avec Tim Knapen ouvrent la voie à un usage spécifique des machines 3D par les designers. En fait, ils ne vont pas inventer le principe de la RepRap, comme on l'a vu, mais initier un rapport artistique aux imprimantes 3D.
La particularité de leur approche sera d'interroger la machine en tant que designer. N'étant ni ingénieurs, ni techniciens, ni artisans d'art, ils ne vont pas chercher seulement à la perfectionner techniquement, mais à déceler des principes productifs et à identifier des qualités physiques et matérielles de la matière. Tout d'abord, ils vont opérer une spécialisation de la RepRap classique en proposant de remplacer le fil plastique qui est généralement utilisé du type PLA, par une matière liquide et ductile : de la céramique. Par ce changement de matière et ce détournement de la machine, ils vont en quelque sorte désorienter l'impression 3D classique de ces usages les plus courants. Bien que l'impression 3D à base de céramique, notamment de poudre céramique, existait déjà dans l'industrie avant 2010, on trouve des brevets d'impression 3D céramique avant cette date, ce qu'ils vont inventer, c'est un couplage inédit. Ce qui va les intéresser, c'est plus précisément la façon dont il va être possible d'extruder la matière et de la déposer par fines couches de façon stratigraphique, donnant lieu à des résultats qui seraient impossibles à obtenir autrement, notamment manuellement. Il en ressort un travail très fin de dépose de la matière par extrusion. Pour cela, ils vont avoir recours à une interface logicielle, un slicer, indispensable pour décomposer le modèle en fines strates, et définir le cheminement de la buse.
Il s'agit en fait du même principe que l'impression 3D avec dépôt de fils fondu (FDM), la différence est qu'il n'y a pas ici de réchauffement de la matière. Il s'agit d'une extrusion à froid de la céramique par compression. Il n'est alors aucunement question de masquer le dépôt de fils, contrairement à l'industrie qui promeut l'impression 3D sur la base de la rapidité d'exécution et de la finesse de la résolution, mais d'en révéler le potentiel esthétique. Le collectif Unfold va ainsi assumer pleinement la visibilité de ces couches et en tirer parti esthétiquement, ce qui donnera lieu à une série d'expérimentations qui ne peuvent être obtenues que dans ces conditions et selon ce protocole spécifique fondé sur la mise en corrélation d'un complexe qui va allier modèles 3D, machines pilotées numériquement, matière céramique et observation de la réaction de la matière, pour ensuite modifier le modèle initial. Une espèce de boucle se met en place et de va-et-vient possible entre ces différents moments et temps de production. Il faut par ailleurs souligner que le collectif Unfold va exposer ce travail et leurs machines, donnant lieu à de véritables installations et performances en interaction avec le public. Tel était le cas lors de l'exposition au CBK de Rotterdam où les visiteurs pouvaient façonner virtuellement une forme dans l'espace, sans même toucher la matière. Les mouvements de la main sont ainsi interprétés numériquement par un laser ; les données sont ensuite transmises à un ordinateur permettant de les traiter et de les restituer à l'écran en temps réel. Les différents modèles produits par les visiteurs vont ensuite être projetés sur le mur, créant ainsi une galerie virtuelle des différents modèles ainsi générés. La forme de départ est ainsi un volume cylindrique qui va être progressivement tourné et modelé, comme pourrait le faire traditionnellement un potier à l'aide de son tour. Sauf qu'ici, à la différence du tour de potier classique, le processus génératif est entièrement numérique fondé sur une succession de micros étapes interprétatives. Les données physiques sont alors traduites en coordonnées spatiales et transposées sous la forme d'une figure facettée avec ce que l'on appelle des mesh (maillage tridimensionnel) qui vont simplifier la forme et donner l'impression d\'un vase relativement courbe alors qu'il est en réalité composé de surfaces triangulées.
Les résultats sont ensuite disposés sur des étagères qui composent une sorte de cabinet de curiosités où ces formes à la fois familières et étranges sont exposées : familières parce qu'il s'agit bien évidemment encore d'une typologie d'objets reconnaissables - des vases, de petits contenants - et en même temps totalement étranges, au sens où ils sont le résultat d'un processus totalement inédit à travers lequel transparaît encore le modèle informatique. On voit par exemple encore les traces du maillage tridimensionnel à travers les objets ainsi obtenus.
Autre particularité à souligner concerne les modalités d'exposition de leur dispositif. Unfold aurait pu se contenter d'exposer les objets ainsi obtenus seuls de façon décontextualisée. Or, ils ont choisi d'exposer l'ensemble du processus d'obtention des formes, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qui ont permis d'obtenir un résultat, mettant en place un protocole productif davantage que des pièces uniques. C'est dans cette interaction avec la machine et dans les va-et-vient entre modélisation, production, observation de la transformation de la matière que le designer et l'usager vont pouvoir modifier leurs modèles ainsi que leurs protocoles productifs et générer ainsi des résultats différents.
Au centre d'art Z33 de Hasselt, en Belgique, L'Artisan Électronique a donné lieu à une autre forme d'installation. Sur une même table se succèdent la modélisation spatiale, la visualisation du modelage virtuel, la préparation de la matière et l'impression 3D du modèle. Cette façon d'exposer le processus de production n'est pas tout à fait unique. En effet, plusieurs designers vont, dans les années 2010, développer des installations et exposer leurs machines selon un mode de présentation linéaire qui semble bien plutôt faire référence au modèle de la grande industrie que le contester. Je me suis d'ailleurs longtemps interrogée sur les raisons qui poussent ces designers à reprendre un modèle d'organisation industriel alors même qu'ils semblent vouloir s'affranchir de l'industrie propriétaire dominante.
Tel est le cas du collectif Studio Lo qui, à la même époque, va mettre au point une petite CNC low-tech portative qui prend le contre-pied des CNC industrielles très imposantes et très difficilement déplaçables, afin de répondre à une demande de production de proximité. Leur démarche donnera lieu à un appel à projets et à des productions issues de cette machine qui seront exposées à la galerie Ars Longa à Paris, reprenant un mode d'exposition en ligne : de la zone de conception et de modélisation, au centre d'usinage (dans la petite usine au centre), jusqu'au magasin.
Cette modalité de présentation des machines selon un arrangement linéaire de la production renvoie bien évidemment directement à des types d'organisations rationnelles productivistes du travail industriel, fondées notamment sur la parcellisation des tâches et l'apparition de la ligne de montage. Dans le cas du fordisme qui décompose les tâches complexes en tâches élémentaires et hiérarchisées de façon successive et répétitive, le travail est apporté à l'ouvrier, non l'inverse, ce dernier exécutant des opérations limitées et strictement définies qui lui sont allouées. La méthode se révèle particulièrement efficace. Pour repère le temps de montage d'une forme T est, à cette époque, divisée par 12 dans les années 20. Ce qui est extrêmement représentatif de cette logique de production.
D'autres exemples, présentent des caractéristiques similaires mettant en avant une mise en ligne du processus fabricatif low-tech en design. Tel est le cas de l'exposition C-Fabriek. The Creative Factories (2011) qui présentait 14 lignes de production low-tech, sous la direction curatoriale de Thomas Ohaly et Thomas Vailly12. Dans ces différents dispositifs, contrairement à la ligne de montage industrielle, le visiteur et utilisateur de ces machines est actif et se déplace d'un poste à un autre, l'enjeu n'est pas ici l'optimisation du travail et l'augmentation de la production, même s'il y a bien une mise en évidence d'un processus sur le mode linéaire, mais au contraire une implication active de la part du visiteur au sein du dispositif productif permettant une prise de conscience et compréhension de ce qu'il génère.
Dernier exemple pour cette deuxième partie, est la ligne de production de Dave Hakkens et sa proposition intitulée Precious Plastic, qui date de 2013. Cette proposition présente également une exposition linéaire du processus productif. Dave Hakkens conçoit ici une petite usine de transformation de déchets plastiques permettant diverses actions (broyage, extrusion, compression, injection dans un moule), donnant lieu à des objets aux formes irrégulières et à la matérialité singulière qui ne sont pas dépourvus de qualités esthétiques, bien au contraire.
Sur ce schéma qu'il produit en 2013, on voit la logique du recyclage des matières plastiques. Il fait le constat que 80% des matières produites sont jetées, 10% sont transformées, donc transformées ou détruites pour produire de l'énergie, et 10% seulement sont recyclées, lavées, broyées et stabilisées avant de repartir en production, ce qui est extrêmement peu.
Peut-être que le point commun de ces différents exemples repose sur des modalités d'exposition semblables qui citent la production industrielle en ligne tout en produisant une critique de ce modèle productif. Non seulement parce que, d'une part, la chaîne de production est discontinue, mais également parce que cette organisation n'est pas fondée sur la recherche de l'augmentation de la productivité de l'industrie, mais sur l'exposition et la compréhension d'un processus. Ces designers se réfèrent finalement à un processus industriel largement éprouvé pour mieux s'en affranchir ou tout du moins procéder à sa critique. Ils s'inscrivent aussi dans leur époque et dans leur temps, dans cet héritage industriel pour en prendre le contrepied, l'interroger, et proposer autre chose.
1.4 La relation des machines autoproduites au milieu
Enfin, le troisième point que je veux aborder aujourd'hui concerne plus directement encore la relation entre les machines et ce que Bruno Latour appelle le « terrestre ». La troisième idée reçue concerne cette fois-ci le fait de penser qu'au fond, la machine, par essence, ne pourrait entrer dans un rapport de réciprocité positive à l'égard de la terre, du vivant et des éléments. Or, plusieurs designers, ces dernières années, ont développé des machines d'un genre spécifique qui interagissent avec leur environnement physique, atmosphérique et météorologique, de sorte à générer des machines presque sensibles prenant part à leur milieu et qui ne sont pas pensées sur le mode de l'arraisonnement heideggérien, mais d'une écoute attentive de la nature. Tel est le cas du studio autrichien Mischer'Traxler, basé à Vienne, qui a développé depuis 2008 un projet intitulé The Idea of a Tree. L'idée a consisté à créer un dispositif technique capable d'interagir avec la luminosité solaire et de produire une forme qui en soit le résultat.
Son intitulé The Idea of a Tree renvoie littéralement aux principes de croissance des arbres et aux cernes annuels qui matérialisent son développement en fonction des saisons et du climat. Ainsi, en fonction de la journée, la machine va enrouler plus ou moins de fil et le colorer autour d'un moule. Plus l'ensoleillement est important, plus la couche va être épaisse et la couleur claire ; plus l'intensité lumineuse diminue, plus la couche sera fine et la couleur sera sombre. L'objet semble ainsi, par ce procédé, presque pousser devant nos yeux. La machine commence à produire lorsque le soleil se lève et s'arrête lorsque le soleil se couche. Après le coucher du soleil, l'objet est fini et donc prêt quasiment à être récolté. Ce dispositif technique autonome va ainsi utiliser l'énergie solaire pour fonctionner, d'où les panneaux solaires, mais aussi interpréter l'intensité lumineuse et la traduire matériellement à travers cette forme. Selon ce processus, un jour égale un objet. Par conséquent, le temps de production est long ; on est loin de la logique productiviste qui consiste à produire toujours plus rapidement. L'important n'est donc pas la rapidité d'exécution, mais la possibilité de mettre en relation une fabrique avec son milieu. Ainsi, le résultat reflète à la fois les différentes conditions d'ensoleillement qui se produisent au cours d'une journée et l'intensité lumineuse de la région du monde dans laquelle la machine se trouve. Comme le soulignent les designers Katharina Mischer et Thomas Traxler : « le produit devient une représentation tridimensionnelle du jour et de l'espace où il est produit et communique certaines caractéristiques de la localité. Cette localité industrialisée n'est pas tant une question de culture, d'artisanat ou de ressources locales, mais plutôt de facteurs climatiques et environnementaux du processus qui l'entoure13. »
Je terminerai ma présentation sur le travail de Sander Wassink et Olivier van Herpt et leur dispositif de production Adaptive Manufacturing, qui a été pensé pour être réceptif à son environnement. Bien qu'ils ne détaillent pas exactement la nature de leurs scripts, ils indiquent que certaines informations externes sont mesurées par des capteurs qui sont ensuite traduites en comportement via un logiciel, puis transmises à l'imprimante 3D céramique grand format qu'Olivier van Herpt a conçue et fabriquée et qui les restitue un peu à la façon d'un sismographe. Ils ont d'ailleurs exposé le fruit de leur travail lors de la Dutch Design Week en 2015, au sein de l'exposition Thing Nothing, où ils montraient à la fois les pièces ainsi obtenues, mais également les tracés informatiques. Faisant le constat que « nous avons perdu la traduction des influences locales dans nos produits », ils proposent une machine capable de détecter l'environnement local et de l'intégrer dans le processus de production, tout en continuant à affecter un pouvoir décisionnaire à l\'être humain qui peut infléchir le résultat, sélectionner certaines informations plutôt que d'autres.
1.5 Conclusion
À travers ces différents exemples de production et de machines auto-produites par des designers, je voulais montrer qu'il existe au sein même du système productif actuel, une autocritique de l'industrie par les designers eux-mêmes. Comme j'ai tenté de vous le montrer, les designers, à travers leurs productions de machines, ne s'opposent pas frontalement au « système technicien» (J. Ellul), ils le citent, y font référence jusque dans la façon d'exposer leurs propres productions, ils l'infiltrent, s'en servent pour le détourner et faire exister d'autres modalités productibles, ils le déstabilisent en quelque sorte en mettant en place ce que Michel de Certeau appelle des « traverses ». Prenant le contrepied des visées expansionnistes et productivistes de l'industrie et en y invitant une part de poésie, il y a au fond, ces productions portent en elles une promesse créative et libératoire. Si L. Mumford a invité à se révolter contre le système, ces designers ont opté pour une démarche plus discrète, mais néanmoins très porteuse, celle de créer des formes et des machines alternatives, des machines plus ou moins insubordonnées au système, qui acceptent un jeu, une sorte d'espacement qui intègre l'accident, le temps long, le non calculable comme facteur de création. Le travail du designer consiste donc autant à piloter des machines qu'à se frayer un chemin dans les processus d'automatisation, à les limiter parfois, à désigner peut-être ceux qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas, ou à identifier les situations qui empêchent au fond qu'une part sensible dans ce processus mécanique puisse exister. Son rôle est donc essentiel, car sinon, l'ingénierie des machines aurait tendance à pousser vers toujours plus d'automatisation, réduisant de fait les possibilités d'intervention humaine. Là réside sans doute une responsabilité de sa part, un travail, une mission, pourrait-on dire, qui se joue sur le plan créatif et au-delà, et qui consiste à faire exister cette discontinuité, ces espacements, ce jeu qui n'est pas à combler, mais qui rend possible un travail créatif et heureux permettant de faire place à quelque chose qui peut encore émerveiller.
Je vous remercie.
2. Discussion
Catherine Chomarat-Ruiz
Merci à toi Sophie pour cette belle conférence introductive. Je pense qu'il y a beaucoup de questions ou de remarques à faire. Ce qui me frappe, c'est ce lien entre ce que montrent ces designers et la question de l'exposition qui est finalement omniprésente. Mais je pense que ça serait bien de tout de suite laisser la parole aux étudiants qui ont préparé des questions. Je crois qu'il y a une demande de prise de parole de la part de Cassandra, si je ne me trompe pas, et ensuite d'Aida.
Cassandra Bonnafous
Merci, déjà, c'est très intéressant. Je voulais revenir sur un fait. Vous avez évoqué quelques fois la notion de la temporalité et de la vitesse de création. Et pour le projet relatif à l'ensoleillement notamment, j'avais l'impression que vous sous-entendiez que la lenteur de création était en fait un point positif du projet et que c'était quelque chose qui était appréciable. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez développer un peu cette question de la temporalité avec les machines. Est-ce que cette lenteur peut être gage de qualité ou en tout cas aller en contradiction si je peux dire avec ce qu'on imagine des machines et des techniques qui finalement d'habitude permettent d'aller plus vite ? Est-ce que c'est justement ce paradoxe-là et cette utilisation différente des machines qui fait que pour vous la lenteur peut devenir une qualité ou est-ce que ce sont d'autres aspects qui rendent ces propositions intéressantes ?
Sophie Fétro
Je pense que vous cernez bien des choses. L'intérêt de cette proposition est de faire exister peut-être d'autres temporalités. La vitesse n'est pas mauvaise en soi. Le problème s'accentue lorsque la rapidité d'exécution s'impose comme seul rapport machinique possible. C'est donc en cela que la lenteur est intéressante. C'est aussi parce qu'elle fait exister un autre rapport possible à notre environnement et d'autres modalités de production. Le problème actuel est que l'industrie dominante n'a de cesse de s'imposer comme seul modèle possible. Finalement, le studio autrichien Mischer'Traxler propose une respiration, un autre temps possible. Et si, au fond, il était possible de produire plus lentement? Ce qui en résulterait serait-il de qualité ou pas ? En fait, on s'aperçoit que dans cette production lente, on a peut-être plus à y gagner que dans une recherche d'accélération continue et permanente parce q'on voit bien que cette logique est intenable. Cela interroge le sens même de la rapidité productive. Pourquoi vouloir produire toujours plus rapidement ? On le voit bien à travers l'industrie, la raison même de la production rapide, repose sur l'idée d'une production sans cesse renouvelée d'objets ou de services afin qu'ils puissent être écoulés et favoriser un rendement toujours plus important, un roulement des objets qui sera toujours plus grand. On voit bien que l'on arrive cependant au terme de cette logique avec les limites environnementales que l'on connaît. Cette piste du ralentissement temporel de la production constitue peut-être une voie possible et positive. Personnellement, je trouve qu'elle fait du bien parce qu'elle nous dit que l'on a peut-être à y gagner dans un rapport qui ne serait plus régi par la seule recherche du bénéfice permanent. C'est donc une alternative intéressante. Sur la lenteur, évidemment, on pense à Pierre Sansot, L'éloge de la lenteur, mais je ne voudrais pas non plus que l'on pense que la vitesse n'est pas intéressante. Par exemple, la vitesse, c'est aussi ce qui permet dans le cinéma de générer une image en mouvement. Donc, quelque part dans certaines situations, comme le cinéma, la vitesse de rotation que permet la machine, est indispensable pour que le cinéma en tant qu'expérience perceptive puisse exister. Ces propositions sont en tout cas une invitation à interroger la finalité même de l'entraînement mécanique et du dispositif produit, car c'est ce qu'on en fait qui est essentiel ou potentiellement destructeur.
Cassandra Bonnafous
Finalement, si la machine n'est plus utilisée dans le but d'aller plus vite, quand nous étudiants en design, par exemple, on observe ce genre de projet, il faut justement, essayer de se concentrer sur les autres avantages ou les autres nouveautés que la machine apporte finalement, comme dans le cas du projet de Mischer'Traxler. Encore une fois, ce sont des choses qui n'auraient pas forcément pu être faites autrement. Et donc, la machine apporte autre chose qui n'est pas la vitesse, mais qui est quand même quelque chose de différent par rapport à l'artisanat ou à la création manuelle.
Sophie Fétro
Tout à fait. C'est une qualité, il y a une qualité de forme, potentiellement ce dispositif produit quand même 365 objets par an, ce qui n'est pas rien non plus sur le plan de la production. On peut venir à se demander si ce n'est pas déjà suffisant à l'échelle d'un quartier ou d'une ville.
Catherine Chomarat-Ruiz
D'autres questions ?
Aida Abbou
Oui. Au début de votre intervention, vous avez parlé de la mégamachine. Est-ce que vous pensez que c'est la création de certaines machines qui n'est pas éthique ou l'usage qui est fait par les designers et les fabricants de ces machines-là ?
Sophie Fétro
Si l'on écoute Frank Lloyd Wright, effectivement, la machine n'est pas mauvaise en elle-même. En fait, c'est ce qu'on en fait qui va être bon ou mauvais. Nécessairement, cela replace l'être humain au centre du dispositif machinique, en le mettant face à ses responsabilités. Ce qui pose énormément de questions et a engendré de nombreux débats très importants au cours du XXe siècle. Cela pose effectivement la question de la responsabilité de celui qui fabrique les machines et de ceux qui s'en servent, de ceux à qui elle est destinée et du complexe du système technique. Parce que l'on sait bien que le problème aujourd'hui est de trouver les responsables d'un système machinique qui n'est pas très clair aujourd'hui et pour lequel il n'existe pas un seul responsable, mais des co-responsabilités, des responsabilités partagées qui sont parfois diffuses et confuses. Ce sont presque à ce moment-là des enjeux juridiques qui se posent à l'égard notamment du système informatique, ou des réseaux. Qui est responsable dans ces systèmes-là ? Toute la question est là.
Céline
En fait je me demandais sur la dernière référence si vous aviez des informations. En fait, vous disiez que les vases étaient paramétrés par des données de l'environnement local et je me demandais si vous connaissiez quelques-unes de ces données puisque j'ai du mal à imaginer de quoi on parle exactement.
Sophie Fétro
Effectivement, la question se pose et j'ai moi-même très envie de leur poser cette question. En fait, ce sont certainement des données locales du type température, déplacements de flux, captation d'informations diverses, etc. Il faudrait leur poser la question de façon plus précise. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'information. Ils ne communiquent pas précisément là-dessus, alors que l'idée même de leur fabrique repose précisément sur une interaction avec le milieu. Pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les données du milieu prises en considération, ce qui est dommage. Peut-être qu'ils veulent garder cette information encore secrète. Il y a encore peut-être quelque chose à décrypter dans ce dispositif-là. On peut faire cependant des hypothèses car, aujourd'hui, on sait très bien capter le son, on sait capter des données thermiques, des mouvements, etc. Toutes ces données-là peuvent être interprétées numériquement et donner lieu à des variations. Après lesquelles sont vraiment mises en jeu dans ce projet, cela reste à préciser. Je pense qu'elles sont multiples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les pièces montrées, on voit parfois des aspérités, des irrégularités, et à d'autres moments, on voit au contraire quelque chose de plutôt régulier. Il y a une sorte d'alternance pour montrer qu'à un moment donné, on peut choisir telle ou telle option ou tel paramétrage plutôt qu'un autre. C'est un projet relativement récent, malgré tout. Donc, il faudrait creuser un peu la chose.
Céline
Merci.
Catherine Chomarat-Ruiz
Deux autres questions.
Andrés Cobos
Bonjour. En fait, vous avez parlé de la notion d'artisanat numérique. Est-ce que justement dans ce rapport aux machines, le numérique aurait un rôle néfaste dans les savoir-faire manuels ?
Sophie Fétro
Personnellement, je ne pense pas. Mais la question, est peut-être de savoir ce que fait le numérique à l'artisanat et inversement ? Il y a des designers qui, justement, s'intéressent à cette relation-là entre artisanat et numérique, parfois empruntent des logiques informatiques sans même avoir recours à l'informatique ou, au contraire, sollicitent l'informatique pour produire des choses qu'ils ne pourraient pas obtenir de façon artisanale. Pour ma part, je pense que le numérique et la production artisanale ou les savoir-faire artisanaux ne sont pas véritablement à opposer, mais à envisager comme de nouvelles possibilités, c'est-à-dire des possibilités d'hybridation qui permettent de générer non pas une opposition de l'artisan ou de l'artisanat au numérique, mais de penser des couplages. C'est exactement l'enjeu d'Unfold quand ils font L'Artisan Électronique. Au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas le fait de dire que le numérique va remplacer le potier traditionnel, plutôt de dire qu'au fond, la machine peut générer quelque chose de différent que l'artisan ne peut pas faire. Cela ne remet pas en question la légitimité de la production artisanale, cela lui ouvre des possibilités.
Catherine Chomarat-Ruiz
Lucy, c'est à vous.
Lucy Doherty
Bonjour, je voulais rebondir sur les dernières références que vous avez présentées parce que j'ai eu la sensation forte que tous ces projets étaient quelque part en train de détourner l'utilisation de la machine pour réintégrer, comme vous disiez, de la poésie ou comme au début, de la rature, de l'anomalie, ce qui caractérise l'humain naturellement et fait partie de lui. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu avec la machine au début de son utilisation. Tous ces projets rendent finalement floue la limite entre l'outil et la machine. Aussi, est-ce que vous croyez que l'on devrait davantage parler d'outil que de machine dès lors qu'il est question d'un processus créatif par un designer ou un artiste ?
Sophie Fétro
Il y a plusieurs questions emboîtées dans votre intervention. Mais au fond, il y a quand même quelque chose dans ces démarches qui tentent en fait d'humaniser la machine. À quoi rimerait au fond cette machine à travers laquelle l'être humain ne se retrouverait plus ? Il transparaît à travers ces démarches, la volonté de produire un certain type de relation, de réciprocité positive ou en tout cas un rapport non conflictuel et destructeur avec la machine, afin de l'envisager non pas selon l'angle d'un rapport de force parce que finalement, dès qu'on envisage la machine sous cet angle-là, il faut être lucide la machine l'emporte clairement. Si pour certaines actions, comme par exemple soulever une charge, aller plus vite, calculer plus vite, etc., on sait que la machine est performante et supérieure à l'être humain, la question est alors de savoir ce que peut encore l'être humain dans ces processus ? À quel moment cela vaut-il la peine de solliciter les machines ou l'être humain ou les deux ? Qu'en attendre et qu'est-ce qu'on sollicite de la machine ? Donc, peut être que la machine devient un outil quand elle n'est plus concurrentielle ou n'est plus seulement envisagée dans un rapport de concurrence à l'être humain.
3. Conférence d'Émile De Visscher
L'exercice que je vais entreprendre ici constitue un passage de flambeau, car de nombreux éléments passionnants ont déjà été soulevés par Sophie précédemment. Je vais adapter ma présentation et revenir sur certains points, comme notamment la curiosité, la ruse, la coïncidence des opposés ou la linéarité dans les formats d'exposition. Néanmoins, il me semble qu'une différence va résider dans l'analyse de la machine en tant qu'agent d'organisation socio-technique, au-delà de son contexte d'exposition. On pourra y revenir par la suite.
3.1 Éléments de contexte
Vous m'excuserez de sa banalité, mais je vais commencer ici par poser une sorte d'évidence qui me semble pourtant nécessaire pour aborder le sujet de manière informée : l'anthropocène, la grande accélération, la crise écologique - on l'appelle comme on veut- nous demande de modifier nos moyens de production. Le nom ou l'origine exacte assignée à ce phénomène peut être sujet à débat. Néanmoins, il y a consensus sur le fait que le système industriel tel qu'il s'est développé au XIXe siècle en Angleterre, a eu un impact drastique sur la qualité de l'air, la qualité des sols, l'extraction et l'exploitation de toutes les matières possibles et imaginables dans le monde entier, le développement de logiques mono-culturelles ou mono-matériaux, etc. De ce fait, les designers se retrouvent actuellement pris dans une sorte de paradoxe, voire parfois de schizophrénie. On le remarque très clairement, notamment chez les jeunes designers, parce qu'ils héritent et s'inscrivent dans une discipline dont les outils, les concepts, les méthodes, et l'histoire sont fondamentalement liés à l'outil industriel. Un système de production auquel ils ne veulent plus participer et qu'ils ne souhaitent plus cautionner. Alors évidemment, il y a aujourd'hui de nombreuses manières de pratiquer le design sans avoir affaire à l'industrie : design de service, design spéculatif, design de politique publique, etc. Mais il me semble qu'une des émanations de ce paradoxe réside dans cette tendance à imaginer des manières de produire autrement, de se désolidariser de la logique industrielle pour explorer d'autres modalités productives - comme le disait très bien Sophie précédemment.
Voici une fresque rassemblant une série de projets de ce type (je ne sais pas si vous verrez beaucoup, ça sera sans doute un peu petit) dont on peut observer la multiplication à partir de 2008. La fresque s'arrête en 2018 mais son développement est exponentiel. Dans les masters de design actuellement, on remarque une influence grandissante de ce type d'approches : on ne compte plus le nombre de projets de nouveaux matériaux, de procédés mêlant artisanat et automation, d'imprimantes détournées, etc. Les techniques de production semblent être devenues une préoccupation centrale de design, en tout cas en Europe.
3.2 Design et industrie
Pour en comprendre les logiques, nous allons commencer par détailler certaines caractéristiques contre lesquelles ces initiatives se développent. Parce que comme le disait Sophie, c'est toujours en référence au système industriel qu'elles s'articulent.
Le premier élément à prendre en compte concerne la déterritorialisation qu'opère l'industrie. Déjà la manufacture, avant même qu'elle ne se transforme en industrie, a pour impact premier de déplacer des artisans des campagnes, de délier les zones d'extractions des zones de transformations de matériaux et des zones de vente, d'exploitations, voire des déchets. L'industrie est corrélative de formes de déterritorialisation et repose entièrement sur la question des transports. C'est tout à fait évident en soit : si vous avez une usine qui produit 10.000 brosses à dents par jour, ce n'est pas localement qu'elle peut extraire les matières nécessaires, ni qu'elle pourra les écouler -- elle a besoin de distribuer ses produits dans une région très vaste. La concentration des moyens de production amène des formes de déterritorialisation particulièrement prégnantes, aussi bien en termes matériels, qu'humains et informationnels (on peut penser au brevet par exemple). En réaction à cela, un certain nombre de designers tentent, au même titre que d'autres disciplines (on va revenir sur ce point), d'imaginer ce que pourraient être des productions territorialisées, qui n'ont pas ces besoins de déterritorialisation. Et à ce titre, je vais parler d'un projet que j'ai développé depuis 2011 (projet très proche de celui déjà mentionné aujourd'hui de Dave Hakkens Precious Plastic - qui a été développé à peu près au même moment) et qui s'appelle Polyfloss. Polyfloss est une machine de recyclage de thermoplastique qui fonctionne comme une machine à barbe à papa. Les déchets plastiques sont extrudés par centrifugation à chaud et produisent des fibres. Ces fibres peuvent être utilisées telles quelles pour de l'isolation ou du rembourrage. Mais on peut aussi l'utiliser comme une fibre dans le cadre des textiles par des procédés de filage, tressage, tricot, feutrage, etc., et puis on peut aussi la fondre dans des moules relativement simples pour obtenir des coques rigides.
Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il a permis d'installer un atelier de recyclage local à Madagascar. En 2018, nous avons été invités par une fondation d'entreprise, Rubis Mécénat, en lien avec une série d'ONG locales de réinsertion sociale, et nous avons installé, formé, construit l'atelier. C'est surtout maintenant une série de jeunes qui gèrent leur propre entreprise de recyclage. Ils ont eux-mêmes mis en place un réseau de collecteurs de déchets plastiques qu'ils rachètent, lavent, broient, puis transforment en fibre. Ensuite, ils peuvent vendre la fibre et, ainsi, alimenter en fil les réseaux d'artisanats locaux. En créant du fil recyclé, le projet permet de se lier à des savoir-faire existants au travers du cordage, du tissage, du filage.
Ce qui est intéressant c'est que l'artisanat du fil malgache est réputé mondialement, mais il est actuellement en grande difficulté parce qu'il n'a plus accès à ses propres matières premières. En effet, les fibres de cisal, de soie sauvage ou de rafia, sont de très bonne qualité à Madagascar et elles sont donc de plus en plus vendues à l'étranger. En proposant une nouvelle fibre basée sur les déchets locaux, on réinsère ces réseaux d'artisanat et crée une sorte de petit écosystème local, de nouvelles formes d'attachement. Donc c'est un projet qui permet d'expérimenter une économie locale basée sur une technologie qui est relativement simple : on passe juste du grain à la fibre. Mais cette transformation-là permet de connecter énormément d'acteurs et de matériaux sur ce territoire. Voilà quelques-uns des objets qui étaient en développement. Et donc ces fibres que vous voyez, ces plastiques recyclés viennent des tubes récoltés dans les déchetteries et les poubelles publiques.
3.3 Design et conception
Une deuxième caractéristique dont j'aimerais parler aujourd'hui, qui est en fait corrélative à la première, c'est la question de l'extensibilité, que les anglais appellent « scalability ». J'ai eu cette expérience-là de « pitcher » un projet à des investisseurs et la première question qu'ils m'ont posée était déjà : « Is it scalable ? ». C'est-à-dire que le principe même du développement technique dans l'industrie nie les questions d'échelle, nie les différences dimensionnelles. Dans le cadre technico-économique actuel, il faut que ce soit la même chose, la même problématique, de produire trois objets que d'en produire dix millions. La différence ne doit résider que sur des moyens (investissement ou marché) mais pas une différence technique, ni humaine, ni territoriale, ni politique. Cela signifie que certaines technologies sont mises de côté parce qu'elles ne peuvent pas être étendues à l'infini. Elles sont liées à des écosystèmes, à des échelles spécifiques. Et c'est vrai tout aussi bien pour les questions d'échelle en termes d'espace que d'échelle temporelle, c'est-à-dire que la technique, dans le cadre industriel, doit pouvoir être accélérée à l'infini. Là aussi il y a beaucoup de designers qui explorent des procédés lents ou des procédés qui ne peuvent pas changer d'échelle. À ce titre, je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis longtemps : Pearling. Au départ, je me posais la question de la fabrication locale (de nouveau), et je me disais si on pense fabrication locale, il faut aussi penser fabrication lente. Puisqu'à l'échelle locale, on n'a pas besoin d'une brosse à dents ou d'un pot de liquide vaisselle toutes les minutes, ça n'aurait aucun sens. Donc on peut considérer des fabrications lentes à ces échelles-là. Je me suis alors intéressé aux fabrications lentes et notamment à la perle. Suite à des recherches, je suis tombé sur un article scientifique extrêmement intéressant d'un laboratoire aux États-Unis qui émettait un protocole pour reproduire la manière dont l'huître crée la nacre. Il s'agissait d'un principe chimique avec une série de bains, qui recrée des couches de matière successives comme dans l'huître. Mais l'article concluait en disant qu'on ne peut pas accélérer la production. Il s'agissait d'une mécanisation d'un procédé naturel, mais donc on devait garder la lenteur originelle. Je trouvais ça absolument passionnant.
Donc j'ai repris cette étude, j'ai changé les compositions pour que ça soit plus stable et j'ai développé une machine de production. Il y a eu deux versions : une première qui était vraiment avec une seule bille et qui prenait la forme d'une d'horloge, c'est-à-dire avec un mécanisme à pendule ; et une deuxième avec six billes qui trempaient dans différents bains de matières. Évidemment, avec ce principe, on peut jouer sur les formes des objets perlés, on n'est plus lié nécessairement à la bille. La machine crée une matière qui est très proche de la nacre, en termes chimiques et mécaniques. Dans le cas de la nacre naturelle, il y a une sorte de perfection interne, une structure géométrique microscopique, qui est très difficile à obtenir. Mais disons que c'est une quête pour arriver à la nacre. Évidemment la première question que l'on m'a posée quand je l'ai présentée, c'est : est-ce qu'on peut l'accélérer ? J'ai dit : non, c'est tout le principe. Donc il y a un jeu avec la question de l'exposition de cette machine, puisqu'elle est tellement lente que le procédé lui-même devient presque plus important que ce qu'elle produit.
3.4 Design et matériaux
Un troisième point qui est très important et très visible notamment chez les designers, c'est la question des matériaux ; notamment le fait que l'industrie déteste la variabilité et l'activité des matériaux. L'histoire de l'industrie est liée à l'histoire de la science des matériaux que je connais bien puisque c'était mes études initiales. La science des matériaux est une vaste entreprise de stabilisation, de pacification, de standardisation, de normalisation de certaines matières. Tim Ingold fait très bien cette différence entre matériau et matière : la matière étant tout à fait active, combinatoire, anisotrope, inhomogène, elle n'arrête pas de se recombiner, de se transformer etc. Il dit "connaître une matière c'est connaître son histoire". La matière est toujours évolutive. Par contre le matériau est un terme qui apparait au singulier en 1933 seulement au Larousse, pour désigner des substances utiles à la construction, typiquement les bétons, verres et métaux. Ce sont des substances passives, des objets stables, normés, isotropes, purs. Ce sont des matériaux que l'on a stabilisés, qui ne réagissent plus, des matériaux morts. La science des matériaux, telle que je l'ai étudiée du moins, était limitée aux céramiques techniques, aux métaux standards et aux plastiques d'usage courant. Le problème bien entendu, c'est qu'une fois qu'on a stabilisé ces matériaux, qu'on a créé ces matériaux stables, incapables de se transformer ; on crée directement la question des déchets. S'ils n'ont pas la capacité de se dégrader, de se développer, de se recombiner : ils restent là, même après leur usage. De nombreux designers explorent donc les manières d'utiliser des matériaux actifs, évolutifs, capables de dégradation, de combinaison, d'évolution.
C'est d'ailleurs le cœur de mon poste actuellement, je suis chercheur associé dans un cluster de recherche à Berlin, dont le titre même est Matters of activity : l'activité des matières. Nous sommes presque 150 chercheurs à travailler sur ces questions, on y passe beaucoup de temps. Pour vous parler de ce sujet, je vais vous montrer un projet de mousse. C'est un projet, dont malheureusement je ne peux pas vous montrer beaucoup d'aboutissement parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, mais surtout beaucoup de ratés. L'idée était de faire une sorte d'outil de graffiti avec des mousses éphémères, bio-sourcées, et c'est extrêmement compliqué : ça n'arrête pas de tomber, de se modifier, de pourrir, etc. J'ai du mal à contrôler ce que je fais. Mais je travaille maintenant avec des chimistes de ParisTech pour mettre au point ce procédé de manière plus simple.
3.5 Design et technique
Le quatrième point que j'aimerais soulever concerne la question de la main (dont Sophie a aussi parlé) et de la participation. À ce titre, je me suis intéressé à la cellulose : papier, carton, pâte à papier, corde, etc. C'est un matériau extrêmement simple, connu quasiment de tous. On sait tous faire un cube en papier, nous avons tous déjà un patron en tête et les techniques à disposition, alors que faire un cube en métal ce n'est quand même pas évident. C'est une matière qui est souvent utilisée par les designers pour faire du prototypage, c'est une matière avec laquelle on peut aussi obtenir des degrés de technicités, des formes complexes impossibles à obtenir autrement. Donc je me suis intéressé à ce matériau en me disant : finalement la plupart du temps c'est un outil utilisé pour du prototypage (comme par exemple la chaise de Konstantin Grcic ici présente), qu'il a fabriquée en carton avant de la fabriquer en métal. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il a pris les mesures, il l'a modélisée et puis il l'a faite fabriquer en métal, en béton, etc. Il y a donc toute une série de traductions que je voulais questionner. Et je me suis dit : est-ce qu'il serait possible de prendre ces formes instinctives faites en carton, papier, corde, etc ; et les transformer directement en objets fonctionnels ? En réalité, ce que je voulais faire était de passer d'une matière organique à une matière inorganique. Or, cela existe dans la nature, c'est de la pétrification. À la recherche d'un procédé, j'ai trouvé une étude d'un laboratoire californien ; ils avaient réussi, à partir d'un petit cube de bois dont ils avaient enlevé la lignine (donc la partie polymère du matériau), à infuser de la silice et à le cuire pour obtenir du Carbure de Silicium (qui est un matériau passionnant, une sorte de frère ennemi du diamant). J'ai repris ces études et plutôt que d'enlever la lignine (parce que dans le papier, le carton, etc., il n'y en a déjà plus) j'ai tenté de transformer ces matières directement en céramique. Et j'obtiens des choses vraiment intéressantes, fragiles lorsqu'on parle de papier de quelques millimètres d'épaisseur, mais relativement rigides quand on parle de pâte à papier ou de cordes. J'ai de plus en plus de pièces maintenant, mais je commence à avoir des pièces justement de plus grande ampleur qui permettent potentiellement de rentrer dans le domaine de l'artisanat céramique, voire de collaborer. C'est en tout cas un souhait que j'ai, de pouvoir mettre en lien ce nouvel artisanat basé sur le papier carton avec des savoir-faire existants soit en céramique, soit en pillage, soit en origami...
Voilà donc un certain nombre de points qui me semblent importants pour aborder le design de procédés. Mais paradoxalement ces points ne sont pas spécifiques au design. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions d'économie locale, de participation, de nouveaux artisanats : que ce soit des architectes, des makers, des ingénieurs, des scientifiques, etc.
Mais il y a un autre point sur lequel je vais axer ma présentation à partir de maintenant, qui me paraît pour le coup singulier au design. Pour l'introduire j'aimerai revenir à l'étymologie du mot industrie qui vient du latin industria et qui, comme Pierre Musso nous le rappelle dans un très bel article intitulé « Prolégomènes à une généalogie de l'imaginaire industriel », peut signifier une « activité cachée ». C'est vrai. Je ne sais pas si l'industrie est par essence une activité cachée mais en tout cas on peut dire qu'elle est cachée pour l'instant. S'il y a bien une caractéristique prégnante de l'industrie, c'est qu'on ne la voit pas, on ne sait pas où elle est, on n'en connaît rien. Moi je suis ingénieur de formation, ingénieur en mécanique, je suis sensé être le spécialiste quand même de ces questions, et bien je ne peux pas vous dire grand-chose ni du pull que je porte, ni de la bouteille ici, ni de mon ordinateur, ni de ma souris, ni de mon cahier, ni même de mon stylo. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas comment ils ont été produits, je ne sais pas quels matériaux les constituent, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été extraits, quel type de déchets ils ont produit ? Si ces déchets ont été revalorisés ? Quel type d'énergie ils ont demandé ? Si ce sont des humains ou des machines qui participent à leur fabrication... Toutes ces étapes dans la fabrication des objets du quotidien, ce qui constitue notre environnement quotidien, nous est totalement inconnu. Et c'est vrai aussi pour ce qui se passe après : si je jette mon pot de yaourt dans une poubelle jaune, va-t-il vraiment être recyclé ? Ou est-ce qu'il va finir brûlé et revalorisé ? Ou est-ce qu'il va finir dans une déchèterie ? Si je jette mon ordinateur dans les encombrants, est-ce qu'il va arriver dans une déchèterie au Ghana ? Nous n'en savons rien, enfin moi en tout cas, je n'en sais rien. Je ne peux rien vous dire de tout cela. Deleuze déjà en 1990 disait « nous vivons dans une société du produit et non plus dans une société de la production », parce qu'elle est absente. Et cette méconnaissance pose quand même un problème important vis-à-vis de notre responsabilité écologique. C'est-à-dire qu'on connaît les grands problèmes : on sait qu'il y a un océan de plastique, on sait que les glaciers fondent, on sait que la terre se réchauffe. Et on sait aussi qu'acheter une bouteille d'eau peut potentiellement poser problème. Mais les relations entre ces deux événements figurent dans les relations techniques, et nous n'y avons pas accès - nous n'avons pas accès à toute la série de correspondances et de traductions qui mènent d'un point à un autre. Donc, le problème écologique pose la question de la séparation entre technique et culture au final, question déjà soulevée par Gilbert Simondon dans les années 50. Cette méconnaissance nous déresponsabilise, au sens où Donna Haraway utilise ce terme : elle coupe le mot en trois et dit qu'elle dé-response-abilise, elle nous empêche de répondre.
3.6 Design, culture et société
Alors, dans ma thèse, notamment, je pose cette question : comment rendre les techniques de fabrication, choses publiques ? J'utilise ici les « choses publiques » au sens de Bruno Latour, c'est-à-dire des res-publica : des problèmes communs desquels on peut débattre collectivement pour, démocratiquement, choisir si nous voulons y adhérer ou pas. Si nous devons - si nous voulons - en changer en achetant quel produit, la valider. Typiquement, la machine que vous voyez là, qui fonctionne sur un principe de moulage par soufflage, produit des bouteilles d'eau. Cette machine doit devenir une « chose publique », un problème commun. Alors, cela pose un problème fondamental, qui est celui de l'accès à ce savoir. Parce que si on se rappelle de John Dewey dans Le public et ses problèmes, on saura que pour qu'un public puisse se créer et débattre autour d'un problème, il faut qu'il en saisisse les enjeux. Pour ce faire, il faut s'appuyer sur une notion que G. Simondon avait établie, celle de « culture technique ». Cette notion est utile parce qu'elle permet de différencier des savoirs d'une culture technique. Pour G. Simondon, l'objectif n'est pas de demander à tous de devenir ingénieurs et de comprendre tous les détails d'une machine. Pour prendre un exemple qu'il prenait dans l'un de ses textes : il parle de l'arbre et dit qu'on n'a pas tous besoin de connaître la formule chimique de la chlorophylle ou les formes moléculaires de la cellulose pour comprendre le principe technique de l'arbre. Comprendre les enjeux de l'arbre, c'est savoir que l'arbre capte une certaine forme de CO2, qu'il capte la lumière, qu'il est vert parce qu'il capte certaines ondes de la lumière, qu'il prend des minéraux dans le sol, et qu'il possède un cycle qui transforme ces éléments et rejette de l'oxygène. C'est à partir de cet ordre-là que l'on peut parler d'une culture technique. G. Simondon en appelait à comprendre les machines et les intégrer dans notre culture au sens fort du terme. Car les techniques sont profondément humaines, elles ont un tel impact et une telle agentivité sur nos sociétés, sur la manière dont nous nous organisons, nous rêvons, nous planifions, nous nous déplaçons, nous interagissons, etc. Ne pas comprendre les techniques signifie ne pas nous comprendre nous-même. G. Simondon souhaitait donc que nous ayons tous une culture technique partagée. Pour ce faire, il en appelait à la formation. Il s'appuyait sur la philosophie et la formation, notamment des cours de technologie dès le plus jeune âge, pour que nous ayons tous une formation et une compréhension de la technique. C'est une proposition qui est sans doute tout à fait valable, probablement difficile à instaurer, mais intéressante. Par contre, en tant que designer et ingénieur, la question peut se poser à l'inverse. Plutôt que de demander aux humains de s'intéresser à la technique, de faire un effort d'apprentissage pour y accéder, on peut demander aux techniques de s'intéresser aux humains ou d'intéresser les humains. L'idée, plutôt que de changer les humains sans rien demander aux techniques, serait de modifier les techniques pour les rendre appréhendables. Il s'agirait d'imaginer de nouveaux types de techniques qui ont la capacité de devenir « choses publiques », la capacité de s'insérer dans la société. C'est à mon sens une des caractéristiques du design.
Pour comprendre et qualifier cette relation entre technique et société, nous allons continuer à nous appuyer sur G. Simondon, qui a des termes toujours assez compliqués mais qui sont quand même utiles pour savoir de quoi on parle. Que veut dire faire une machine qui se donne en public ? Nous allons commencer par trois premiers termes simondonniens : le terme « crypto-technique » fonctionne avec « phanéro-technique ». De quoi s'agit-il ? C'est très simple : un objet crypto-technique est un objet qui se cache : typiquement un moteur dans une voiture. On ne voit pas son fonctionnement. Un objet phanéro-technique est un objet qui se montre : il prend l'exemple d'une grue et dit que dans ce cas, on voit tout de suite les vecteurs de force qui se reportent avec les barres métalliques. On voit les poids de béton d'un côté qui supportent la portée horizontale de l'autre, on voit les moteurs et les engrenages, etc. On en voit le fonctionnement. Mais d'après moi, ce n'est pas exactement ce qui se joue chez les designers qui abordent les procédés de fabrication. Ça va être justement ce troisième terme de « techno-esthétique » qui va s'en rapprocher. Pour voir la différence, je vais faire appel à un projet que j'ai fait avec un collectif de designers et de chercheurs nommé LPP. Nous avons monté cette revue qui s'appelle Obliquité (d'ailleurs Maxime Mollon fait partie de ce collectif, vous l'avez entendu il y a peu). Pour le deuxième numéro qui s'appelait Process et qui était sur les procédés de fabrication, nous avons invité un studio qui était l'un des premiers à adopter ce genre d'approche (d'ailleurs au même moment que Mischer'Traxler que Sophie vous a présenté). Voilà le duo, un couple à vrai dire, d'un anglais et d'une hollandaise. Depuis 2007, ils ont développé toute une série de machines et de procédés qui se donnaient à voir en spectacle. Pour eux, dans leurs textes et leurs interviews, montrer le processus était lié à une forme d'authenticité, de transparence, une volonté de donner à voir la formation des objets du quotidien. Mais lorsque je les ai interviewés, je leur ai posé la question directement : « vous parlez beaucoup de transparence, de monstration, de montrer comment les choses sont faites, de montrer la réalité mais est-ce que finalement vous montrer tout ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées ? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments que vous préparez en dehors de la scène ? Est-ce que même les mouvements que vous montrez des machines, vous n'êtes pas en train de choisir leur vitesse, leurs parcours, vous pourriez faire plus lent, plus rapide ? Est-ce que ces choix ne sont pas faits pour des raisons de chorégraphie, et qu'on entre plutôt dans le cadre du théâtre plutôt que dans le cadre de la transparence ? » Parce qu'on est très loin évidemment de ce qu'on peut voir dans un musée des sciences où vous avez des machines auxquelles on a enlevé un carter que l'on a remplacé par une plaque de plexiglas pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Dans leurs installations, il y a une mise en scène. La machine est pensée pour la mise en scène dès le départ. On est dans un autre ordre que dans la question de la transparence uniquement. Nous sommes dans la performance. Ils ont répondu tout à fait positivement à cette question, en trouvant cette remarque passionnante, et en faisant le lien avec des collaborations récentes qu'ils établissent avec des chorégraphes. C'est là, la différence entre phanéro-technie et techno-esthétique, dans un cas on voit ce qui se passe, dans l'autre la machine a été pensée et développée pour une performance, et des choix techniques ont été faits en raison de volontés esthétiques. Il faut bien comprendre ici que dans la pensée de G. Simondon la technique est un mode d'existence, une manière spécifique de venir au monde, une émergence particulière. Donc la techno-esthétique, ce n'est pas une technique à laquelle on pourrait assigner des caractéristiques esthétiques. C'est une technique dont l'apparition même, la manière dont elle a été développée, a pris en compte des aspects esthétiques. Chez les Glithero, les choix techniques sont générés, dès le départ, par des choix de mise en scène. L'aspect performatif n'arrive pas à la fin, il conditionne les choix techniques.
Maintenant je vais arriver à un quatrième terme qui est un terme un peu compliqué : la « techno-phanie ». Un terme sur lequel j'ai beaucoup buté pendant ma thèse mais qui me semble être un terme intéressant et qui va aborder un aspect complémentaire des termes précédents.
« Techno-phanie », vous l'aurez remarqué, est le terme miroir de « phanéro-technique ». Simondon l'a créé de toute pièce, et l'a utilisé uniquement pendant un an, dans une série de cours et de conférences entre 1959 et 1960. Lesquels sont réunis dans le texte Psychosociologie de la technicité, texte qui est réuni, maintenant, dans un ouvrage qui s'appelle Sur la technique. C'est un texte où il utilise ce terme à tort et à travers, presque 50 fois pour qualifier parfois des exemples assez différents, mais une chose est assez claire : il parle de relations symboliques. C'est-à-dire d'objets techniques dont la technicité (c'est-à-dire les opérations techniques) génèrent des relations symboliques. Alors dès qu'on rentre dans le symbole c'est assez compliqué, parce que c'est un terme qui, selon les histoires et traditions disciplinaires, désigne des choses assez différentes. Ici je vais juste donner une définition très simple, qui me semble correspondre à la manière dont il l'a utilisée. Le symbole désigne une relation de correspondance entre un objet présenté là devant moi et un objet absent. On va dire pour l'instant que c'est uniquement ça.
En fait G. Simondon crée le terme « techno-phanie » en réagissant à deux ouvrages d'un autre penseur : Mircea Eliade, historien des religions et qui, quelques années auparavant, avait construit le terme de « hiérophanie ». La hiérophanie définissait ou qualifiait la relation de correspondance qui existe entre les objets dans les cosmologies sacrées. Il explique que typiquement, dans ce cadre, les objets techniques ne sont pas uniquement des objets compris pour leur fonctionnalité. Ils sont aussi saisis par des relations avec des contenus culturels, avec des récits, avec d'autres objets techniques dans la sphère d'une cosmologie spécifique. Il ajoute que même si ces objets sont sacrés, au sens où ils sont vecteurs de relations dans la cosmologie concernée, cela n'enlève en rien la valeur de l'outil. Ce ne sont pas des reliques, des objets de cultes uniquement. La hiérophanie est additive. Elle ajoute des relations de correspondances entre des choses et des gestes, mais n'enlève pas leur réalité utilitaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Eliade, en décrivant et en montrant comment les objets techniques sont intégrés dans les sociétés extra-occidentales ou pré-modernes par toutes ces relations, finit notamment l'un de ses ouvrages en disant : nous avons perdu ces liens, nous n'avons plus aucune relation à nos objets techniques, ils sont uniquement des objets fonctionnels qui n'ont plus de relations à la culture. Les objets techniques ne sont que purs moyens sans sens. Et c'est à cette conclusion que Simondon réagit en créant le terme de techno-phanie. Il tente de soutenir que malgré tout, il doit exister des formes de techno-phanie, donc de techniques modernes dont les fonctionnements ont des capacités symboliques qui se lient avec la culture. Après un an, il abandonne le terme pour passer à d'autres problématiques.
Alors je vais revenir sur mes projets et essayer de montrer pourquoi est-ce qu'il me semble y avoir quelque chose, à chaque fois, de l'ordre de la techno-phanie là-dedans. Si l'on revient à Polyfloss, cette machine de recyclage, je vous en ai parlé d'un point de vue purement utilitaire (comme un moyen pour une fin). Mais il est évidemment qu'elle a un aspect performatif et qu'elle a été pensée comme telle : la machine est visible, elle crée une sorte de spectacle coloré, on est bien dans la techno-esthétique. Mais ce qui est le plus intéressant c'est que c'est une machine à barbe à papa, qui a été transformée pour être utilisée pour du plastique. Présentée dans une exposition par exemple, dès que les gens reconnaissent que c'est une machine à barbe à papa, il y a quelque chose qui change, un déclic qui s'opère. Typiquement on a des gens qui veulent savoir si on peut la manger, qui nous demande si on peut la porter, etc., réaction très étrange alors que l'on parle de déchets plastiques, l'une des pires choses que l'humanité ait créée au XXe siècle. C'est la matière sans valeur, le déchet ultime, le rebut du pétrole. Et tout d'un coup ce lien avec le monde de l'enfance, avec un espace complètement autre, crée une capacité de socialisation très différente pour cette technique. L'association symbolique entre l'opération technique présentée dans Polyfloss et les autres machines de barbe à papa, permet d'établir une série de questions, de compréhensions, de relations, qui ne seraient pas possibles si l'on parlait uniquement d'une machine d'extrusion par exemple. D'ailleurs, l'histoire de la barbe à papa et celle du plastique synthétique sont presque parallèles. Puisque la barbe à papa a été présentée pour la première fois en 1904 à l'exposition universelle de Saint-Louis, au moment même où Léo Bakeland faisait ses premières vulcanisations de polymères. Il les présentera trois ans plus tard, et déposera le premier brevet de plastique synthétique sous le nom de Bakélite. Il y a donc dans ce projet un jeu de rencontre, de liaison d'histoires parallèles.
Si on prend les perles c'est pareil. Je peux vous décrire ce projet comme un procédé de trempage avec une construction de carbonate de calcium et de bio-polymère. Mais évidemment à partir du moment où on reconnaît que c'est une machine de nacre de perles artificielles, une relation complètement différente s'opère à cette machine. Et notamment on parlait de coïncidences des opposés dans le symbole, il y a toujours une ambivalence, qui est passionnante. Notamment dans cette exposition, j'ai eu une visiteuse qui m'a dit : moi, je ne veux pas que les perles soient faites par des machines, je veux que les perles restent faites par des huîtres dans la mer. On commence à en parler et je lui ai dit que les perles fines sont interdites à la pêche dans tous les pays du monde parce que ça détruit des races entières. Donc toutes les perles du marché sont des perles de culture. Dans ce cadre, on met une bille manufacturée à un endroit de l'huître, on renferme l'huître et on la laisse deux ans dans l'eau. Pour 30% des cas, une couche d'un millimètre de matière se sera créée autour et les autres sont jetées. Donc, il s'agit d'une exploitation animale. Est-ce que c'est mieux d'avoir une exploitation animale ou une machine qui crée des perles sachant qu'elles ont la même visée ? La question reste ouverte. Et c'est bien ce lien entre la machine présentée et son référent symbolique, le mollusque, qui crée cette tension. Après, arrive le débat de savoir si les huîtres ont vraiment souffert dans cette exploitation. Est-ce que l'on peut parler d'une espèce à protéger, alors que c'est un mollusque ? Qu'est-ce qui définit l'éthique du vivant ? C'est ça qui est passionnant dans ces relations qui s'opèrent : elles génèrent des questions, des débats, des discussions à propos de nos modes de production, c'est-à-dire une posture démocratique vis-à-vis des techniques.
Je vais aller plus vite, mais je pourrais évidemment vous parler de la question de la pétrification qui pour le coup est extrêmement chargée de référence culturelle, que ce soit chez les grecs mais aussi chez les celtes, les incas ou la culture traditionnelle japonaise et en références aussi à des processus naturels, je vais aller très vite.
3.7 Émile de Visscher : les projets
J'aimerais vous parler d'un dernier projet, un projet qui a commencé cette année, parce que les projets que je vous ai montrés jusqu'ici sont déjà un peu vieux. Je voudrais vous en parler pour vous montrer que ce qui est important de comprendre, notamment vis-à-vis des termes simondonniens que l'on a soulevés, c'est que dès le départ, le développement technique est hybride. Dès le début des projets, se posent des questions qui sont plus de l'ordre de l'imaginaire, du fantasme et des relations symboliques ou esthétiques qu'uniquement des questions fonctionnelles ou opératoires.
Ce projet a commencé à Berlin, en collaboration avec Igor Sauer, qui est chirurgien, directeur d'un laboratoire de chirurgie expérimentale à l'hôpital de La Charité, et de Marie Weinhart, biochimiste à la Freie Universität. On a commencé à collaborer ensemble et très vite ils m'ont dit que le gros enjeu des laboratoires de chirurgie c'est d'arriver à produire des organes artificiels, parce que le manque de dons d'organes est absolument criant partout et c'est un problème urgent qui tue des gens. Donc, en essayant de comprendre les enjeux, ils m'ont montré qu'en fait la question de la génération des cellules n'est pas tellement problématique maintenant. Le gros problème c'est d'arriver à faire des matrices extracellulaires qui sont donc des tissus spongieux qui maintiennent les cellules en place et qui sont plein de réseaux micro-vasculaires pour permettre la circulation du sang à l'intérieur. On s'est dit, ça c'est un brief de designer pour faire une machine, carrément ! Il faut essayer d'imaginer quelque chose de cet ordre. Très vite j'ai fait un lien, qui me paraissait évident, sans doute aussi du fait de mes lectures et de mon intérêt personnel pour l'électricité. Eux ne voyaient pas du tout le rapport mais pour moi il y en avait un très clair. Et il y avait notamment un rapport très clair dans l'histoire extrêmement imbriquée entre soin, mort, vie et électricité. Ça a toujours été, aussi bien par toute une série de techniques expérimentales de soins par l'électricité que des techniques de souffrances, de torture et de mort. Et on pense évidemment à des choses comme Frankenstein, etc. Donc, pour produire des réseaux micro-vasculaires dans un bloc de matière, au début j'ai pensé aux fulgurites (ces formes qui se génèrent lorsqu'un éclair frappe le sable, formant des structures tubulaires en verre fondu). Puis, je commence à expérimenter sur le bois, en m'appuyant sur un artisanat assez développé aux États Unis, le « Lichtenberg Wood Burning ». Ils font ça sur des guitares électriques par exemple : ils mettent des électrodes avec un très haut voltage sur un bois légèrement mouillé, et ça fait cette espèce d'arbre électrique. Mais tout ça m'a amené au final à mettre au point un procédé nouveau qui fait appel, non plus à des électrodes, mais à de l'irradiation d'électrons. J'ai collaboré avec le Laboratoire des Solides Irradiés à Polytechnique pour mettre au point un procédé qui permet de générer ces formes extrêmement fines. On parle de quelques (micromètres) de diamètres, des réseaux plus fins que des cheveux qui sont optimisés par eux-mêmes, puisqu'on recharge la matière et on la décharge d'un coup. Donc tous les électrons partent en optimisant leur parcours. On a donc une sorte d'optimisation comme ce qui se fait pour l'ordinateur, quand on parle d'optimisation sur un logiciel mais en fait par la matière elle-même. Ce qui est intéressant pour moi dans ce projet c'est non seulement le point de vue technique mais aussi le fait qu'il y ait un lien comme ça entre l'irradiation et des formes de vie. Parce que quand on parle de réseaux vasculaires, ce sont des formes de vie, ce sont ce qui constitue l'ensemble de nos corps qu'ils soient humains ou animaux. D'habitude l'irradiation est toujours liée à la destruction, à la mort, justement, à la destruction de la vie, à l'absence de la vie et la souffrance. Mais là, on a une sorte de taux d'irradiation extrêmement léger qui crée des formes vitales. Je trouve que cette tension est extrêmement intéressante, je ne sais pas encore à quoi elle va aboutir, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant à déployer.
Voilà, je vais finir là, je voulais peut-être revenir sur cette question de la spécificité des designers qui traite des machines. Je pense que leur spécificité est vraiment dans ces questions de mise en scène : d'imaginer des machines qui se lient et qui dès le départ sont pensées pour faire partie de la culture et s'insérer dans des espaces humains. A mon sens, on peut même tenter d'établir, non pas une définition mais disons une caractéristique du design sur ce point : être le spécialiste des articulations entre humains et non humains. Chose que les ingénieurs dont je fais partie aussi, ne savent absolument pas faire. Ils ne savent pas penser les relations entre humains et non humains, ça n'existe pas, c'est paniquant. Voilà j'ouvre maintenant le débat.
4. Discussion
Catherine Chomarat-Ruiz
Merci pour cette intervention et pour ce point de vue. C'est curieux les fils qu'on pourrait tisser, je trouve, entre vos interventions. Sur cette question (mais je voudrais quand même que ce soient les étudiants qui dialoguent) ce qui me frappe, c'est cette nécessité de la monstration, qui s'appelle exposition, qui s'appelle techno-phanie, qui s'appelle transparence, enfin l'idée de faire se retourner les choses et les mettre sous le regard. Alors les choses ça peut être des machines, ça peut être des objets, ça peut être des processus. On voit le lien dans vos manières de proposer les choses, avec peut-être d'ailleurs une espèce de doigt pointé sur ce qui serait de l'ordre d'une faiblesse de l'exposition traditionnelle. C'est-à-dire où il faut chercher d'autres formes pour arriver à montrer ce qui est réellement à voir. C'est un centre d'intérêt qui m'est personnel mais qui, me semble-t-il, affleure dans vos propositions. Mais je crois qu'il y a des questions. Camille vous avez la parole.
Camille Mançon
Justement, oui, j'avais une question par rapport à cette question de l'exposition aussi. Quand vous disiez à propos du projet Pearling que finalement au regard de la lenteur de la machine ce qui est le plus important c'est le procédé. Mais il demeure malgré tout invisible quand on on l'observe. Du coup comment on expose un procédé qui demeure invisible au moment où il a lieu ? Et comment arrive-t-on à rendre cette chose-là visible ?
Émile de Visscher
Alors, il se passe quelque chose parce que du coup il y a ces billes qui trempent dans les bains et qui bougent à peu près toutes les 5 - 6 minutes, c'est un gros carrousel avec ces billes. Donc justement c'est une chorégraphie extrêmement lente d'un processus en train de se faire. Effectivement si vous arrivez le premier ou le deuxième jour vous ne verrez quasiment rien. Mais très vite on voit un film qui se produit et qui grandit. C'est sûr que c'est une question très difficile et souvent la vidéo est un peu une réponse. Mais en fait la plupart du temps c'est comme une mauvaise réponse. Parce que justement on n'a plus la matérialité du procédé face à soi. La vidéo, c'est aussi une facilité, parce qu'on peut faire croire que ça marche alors que ça ne marche pas, donc le processus à l'œuvre, faire voir les matières, voire potentiellement les faire manipuler. J'ai fait beaucoup d'ateliers et c'est très important pour moi ces ateliers, parce que c'est aussi des formes d'évaluation : c'est-à-dire qu'en tant que praticien-chercheur habituellement on est plutôt évalué sur des questions théoriques (sur nos écrits). Et donc se pose la question de l'évaluation des productions : est-ce qu'elles sont faites par l'exposition ? Est-ce qu'elles sont faites de manière plus intéressante par les praticiens lors d'un partage de machine, de savoir-faire ? Donc ces moments-là (c'est toute la difficulté) où on peut avoir des retours sur ce qu'on a produit sont très important. Typiquement les discussions avec des visiteurs c'est passionnant. Je veux dire, pour moi en tout cas c'est vraiment des moments très importants pour comprendre si le procédé justement génère quelque chose d'autre que simplement un passage.
Catherine Chomarat-Ruiz
Il y a deux autres questions, dont une posée par Céline, et une autre posée par Coline Bouvet. Céline c'est à vous.
Céline
Oui, je tenais à dire que je ne fais pas partie de vos étudiants, j'espère ne pas prendre beaucoup de temps, si la priorité est aux étudiants.
J'avais aussi une question concernant la machine qui crée des perles. La question posée par la visiteuse et le fait qu'elle aurait préféré que la perle soit faite par une huître, interroge la légitimité de votre machine et de votre projet. Je me demandais, en parlant des symboliques, si dans le processus d'élaboration de votre projet vous avez à un moment donné étudié ce qui fascine dans le fait que l'huître puisse produire une perle. Il y a peut-être quelque chose d'ambivalent et d'étrange car l'huître est à la fois quelque chose de très minéral, on ne sait pas au fond si c'est animé ou inanimé. Il s'en dégage une esthétique très brute. Et puis ça produit quelque chose de très beau qui nous fait rêver et que l'humain a estimé de valorisable. Je me demandais à quel moment vous aviez étudié ou intégré cette dimension de l'ordre de la symbolique, dans le projet ?
Émile de Visscher
Alors, je ne l'ai pas étudiée au sens où j'ai étudié les huîtres, les mécanismes, même essayé de faire une sorte de rapport non pas exhaustif mais sur la signification ont eu les perles dans certaines cultures. Mais je pense que c'est l'inverse : en proposant une mécanisation d'une perle c'est justement la machine qui questionne la valeur de la perle. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument que ces machines se développent au dépend des huîtres, pas du tout. Est-ce que sa valeur vient de sa matière ? De ses relations-ci ? Est-ce que ça vient de son histoire ? Du fait que ce soit le grain de sable qui tombe involontairement entre la membrane et la coque ? Est-ce que ça vient de son espace sphérique, toujours imparfaite ? C'est une belle histoire ? C'est une question ouverte. Et si c'est uniquement le fait que ça prenne énormément de temps, alors les perles produites par ma machine doivent avoir la même valeur. Mais ce n'est sans doute pas le cas, parce que ces perles produites par la machine ont moins de valeur... enfin je n'en sais rien. Avancer avec un projet comme ça permet de soulever ces questions et de ne pas y répondre tout seul. Demander aussi d'avoir les réactions des personnes, pour que tous ensemble se disent : pourquoi est-ce que la perle a autant de valeur ? C'est le seul objet précieux, enfin c'est la seule matière précieuse qui sorte déjà formée. Toutes les autres, il faut les tailler, les couper, etc. Donc c'est un objet absolument fascinant, mais pourquoi ? C'est une question ouverte.
Céline
Vous imaginez que votre projet pourrait évoluer avec des éléments de réponse comme ça? Est-ce que vous imaginez un projet en constante évolution ou est-ce que pour vous pour l'instant il s'arrête là ?
Émile de Visscher
Oui, pour l'instant il s'arrête là. J'ai produit des objets que je n'ai pas montrés là, mais pour l'instant il s'arrête là parce que j'ai envie d'explorer un autre projet. Il va poser potentiellement d'autres questions mais qui ont été amenées par ce projet. C'est un jeu de question/réponse au sein de mes propres pratiques. Et notamment la lenteur, c'est difficile de travailler avec la lenteur. Tout est trop lent, il faut attendre pendant des mois pour avoir un résultat, c'est infernal. Donc je me suis fait prendre à mon propre jeu.
Catherine Chomarat-Ruiz
Dernière question pour cette partie-là. Cette question est posée par Coline Bouvet.
Coline Bouvet
Déjà merci pour votre présentation, c'était extrêmement intéressant. Une question très rapide : je voulais savoir si aviez le titre de l'article dont vous parliez à propos de la formation des perles dans les huîtres ?
Émile de Visscher
Bien sûr ! Est-ce que je peux vous l'envoyer par mail ?
Catherine Chomarat-Ruiz
Oui, si vous me l'envoyez, moi je transmets.
Émile de Visscher
Très bien je vous l'enverrai.
Catherine Chomarat-Ruiz
Alors il y a une demande d'intervention de Laura qui dit : s'il y a encore un peu de temps j'ai également une toute petite question. Alors allez-y Laura, c'est à vous.
Laura Tchatat
Par rapport à ce que vous avez dit vis-à-vis des matériaux, notamment avec le plastique constituant un matériau qui était un peu vu comme Satan, très polluant etc. Je ne nie pas le fait que ce soit vrai, mais est-ce que le fait de créer de nouveaux matériaux comme des bioplastiques avec du maïs, etc. liés avec la quantité, ça ne revient pas au même ? En fait, est-ce que c'est vraiment mieux ? Est-ce que le problème ne vient pas aussi du fait de faire trop de plastique ? Même si, par exemple, on parvient à inventer des matériaux qui sont « plus purs », le fait que ce soit produit en quantité considérable ça ne reviendrait pas aux mêmes impacts au final ? Notamment avec la culture du maïs, on sait très bien que ça prend des surfaces agricoles qui sont quand même assez importantes, avec la consommation en eau, etc. Au niveau des externalités négatives est-ce que ça ne rejoint pas au final celles qui sont créées par le plastique ?
Émile de Visscher
Complètement ! Alors de toute façon la question d'échelle génère un problème. C'est pareil avec le papier... Tous les matériaux dès lors qu'ils sont produits en beaucoup trop grande quantité (ça devient aussi une question de vitesse), ne laissent pas un temps de régénération suffisant pour permettre des cycles qui durent. On arrive très vite à des formes de destruction, surtout si on est sur de la monoculture. C'est en effet la même chose avec le pétrole. Je veux dire que le pétrole ce n'est pas un problème si on l'utilisait à la vitesse à laquelle il se crée. Mais évidemment ce n'est pas du tout le cas. Après, les plastiques c'est quand même une matière qui est très étrange et c'est pour ça, qu'à mon sens je l'ai mise un peu de côté car elle est très spécifique. D'une part, parce que c'est une matière qui est non seulement extrêmement stable (elle met très longtemps à se dégrader), d'autre part, parce qu'elle est vraiment née au début du XXe siècle. Elle n'a pas de savoir-faire, il n'y a pas d'outils pour la travailler, enfin pas avec des outils très récents. A part Precious Platic ou Polyfloss par exemple, mais il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissances distribuées de ce matériau. Au contraire du métal, il y a des recycleurs partout, il y a des ferrailleurs qui connaissent les matériaux, ils ont les outils pour les transformer, ils savent comment les rediriger. Le plastique ça a toutes ces espèces de noms compliqués, comme le polystyrène... On ne connaît pas très bien leurs propriétés, et ce n'est pas en soit le problème de les recycler, parce que ça fond à 200°, c'est relativement facile à remettre en forme. C'est simplement que c'est un matériau qui est extrêmement spécifique, né dans l'industrie. Et qui pour l'instant n'est recyclé qu'au niveau industriel. Et donc il pose un énorme problème. Pour les biomatériaux c'est tout à fait juste. D'ailleurs il y a beaucoup de biomatériaux qui sont considérés comme des solutions alors qu'elles vont poser pleins d'autres problèmes. On parle beaucoup ici et là de l'imprimante 3D, en disant que c'est un plastique bio-sourcé. C'est vrai, mais c'est un plastique qui se dégrade très mal. En fait, la dégradation n'est optimale que dans des conditions industrielles pour pouvoir véritablement réduire son impact. Sinon c'est comme les autres, il est extrêmement stable, il ne se dégrade pas. Cela repousse les problèmes ailleurs. Cela n'empêche pas qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se développent aussi. Il ne faut pas mettre tout dans le même panier et dire que les bioplastiques sont un problème. Je pense que c'est la discussion qu'on avait avec Sophie tout à l'heure : est-ce que la machine est bien ou pas bien ? Ou est-ce que c'est la manière dont on l'utilise ? Il y a des machines très différentes les unes des autres, qui génèrent différents types d'organisations. La machine, il faut s'organiser autour pour la faire fonctionner. Elle devient une sorte d'agent politique aussi qui dit qu'il faut dix personnes pour s'en occuper ; elles doivent s'organiser de telle manière, il faut utiliser tel type de matériau. Donc il faut le trouver, il faut l'extraire... Quelles machines ont des impacts que l'on souhaite poursuivre et quelles machines ont des impacts qui ne nous conviennent pas ? C'est pareil avec le plastique.
5. Conférence de Nolwenn Maudet
Merci beaucoup Catherine pour cette invitation, c'est vraiment bien d'avoir organisé une session sur ce sujet en particulier qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais aussi remercier Émile et Sophie pour leurs présentations vraiment passionnantes, j'ai beaucoup appris et découvert énormément de choses.
5.1 Présentation des questionnements
Je vais sans plus tarder commencer ma propre présentation. Je vais aussi vous parler d'outils et de designers, mais sur un plan un tout petit peu différent et je pense que ce sera vraiment complémentaire avec ce que Sophie et Émilie ont présenté aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, je suis maître de conférences en design à l'université de Strasbourg où j'enseigne en Master Design et en Master multimédias et design numérique. Ma grande thématique pendant mes années de thèse était les outils pour les designers, moins les machines que les outils, et moins les designers qui travaillent avec des objets que les designers graphiques ou designer d'interaction. On est donc à la fois sur un plan très similaire et pourtant, comme vous allez le voir, les questionnements sont assez différents. Je me suis posée une question assez « méta » en tant que designer : comment peut-on concevoir les outils pour les designers, les outils que les designers utilisent eux-mêmes dans leur travail ? Pourquoi je me suis posé cette question ? Pour beaucoup de raisons, l'une d'entre elles étant que, quand j'ai commencé à enquêter sur ce sujet, j'étais étudiante en design, je me suis rendue compte que les logiciels en design avaient radicalement transformé les pratiques, qu'ils avaient fait émerger des métiers entiers, et que, ce qu'on appelle aujourd'hui « designer graphique », n'existait pas avant l'invention de l'informatique et des ordinateurs personnels tels qu'on les connaît aujourd'hui. Avant, la chaîne du livre fonctionnait d'une manière complètement différente, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Rien que le fait d'avoir introduit ces nouveaux outils numériques a radicalement transformé les pratiques, donc la manière dont les designers travaillent.
Ce qui était aussi intéressant c'est qu'après ce moment de transformation radicale ce que j'ai pu constater en tant qu'étudiante en design, et là aussi en creusant un petit peu dans l'histoire, c'est que les outils du design, une fois qu'ils sont apparus et qu'ils se sont solidifiés, avaient réglé la question. Est-ce qu'on serait arrivé au bout de cette question ? Or, au moment où moi j'ai commencé à m'intéresser à cette question, en 2013-2014, on voyait apparaître un vrai intérêt de la part des designers pour la programmation, ce qui existait depuis assez longtemps. Mais l'intérêt de développer leurs propres outils prenait de l'ampleur, les designers s'éloignaient des outils traditionnels. C'est ce qui m'a alors amené à me poser ces questions. Si on regarde les origines même du design, il est lié très fortement à l'intérêt pour les moyens de production. Quand on lit quelqu'un comme Gropius et ceux qui ont travaillé au Bauhaus, qui explique que « par les considérations résolues des méthodes modernes de production, de construction et des matériaux, les formes vont évoluer et souvent être rares et surprenantes puisqu'elles dévient du conventionnel ». Ce qui m'a intéressé à travers ça, c'est l'attention à ce qu'il appelle "les méthodes modernes de production". Et derrière la formulation du design telle qu'on la connaît, il y a vraiment cette attention-là qui a été clé et puis c'est une question qui c'est peut-être un peu perdue à un moment, avant de revenir dans le milieu du design graphique, qui est principalement celui que j'ai étudié, et de revenir de manière très forte avec un nouvel intérêt pour les outils, notamment à travers la programmation et en s'éloignant des outils traditionnels. Se posait alors la question suivante : Est-ce que l'on doit abandonner les outils actuels ? Et pourquoi il existe un écart entre les designers et leurs outils actuellement ? Au moment où j'ai commencé ma thèse, c'était un sujet sur lequel peu de gens s'étaient penchés, ce qui était assez surprenant au vu des pratiques à ce moment-là. Ici, il s'agit ici de l'exemple d'un designer qui dénonce cette illusion de complétude des logiciels, il tente de montrer qu'il faudrait essayer de réformer les choses en allant vers la programmation.
Voilà pour l'introduction de mon propos, ce que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est quatre points qui reprennent quatre dimensions différentes et complémentaires de mon travail autour des outils des designers. Le premier point, qui n'est pas le premier chronologiquement, mais je pense qu'il est important de le traiter en premier parce qu'il permet de poser le contexte, c'est une courte analyse des outils numériques du design, pour essayer de montrer comment ils se sont positionnés jusqu'à présent. Ce qui permettra d'ouvrir sur un deuxième temps, qui explique l'écart assez fort entre les pratiques et les outils. Je me suis aussi intéressée aux pratiques actuelles des designers avec leurs outils au quotidien et quelle relation ils avaient avec leurs outils, est-ce qu'ils les dépassent ou non ? Je parlerai aussi des mythes sur lesquels se sont basés les créateurs des outils pour les designers jusqu'à présent. Et dans un dernier temps, je montrerai les quelques outils et principes de conception qui ont émergé de tout ce travail empirique.
Étant moi-même designer, j'ai travaillé d'après une démarche qui est souvent appelée "recherche par le design" où je combine dans mes recherches trois dimensions différentes : un travail plus théorique et un travail empirique (d'observation, de documentation de pratiques). Ce qui permet de lier les deux est ici un travail de design, qui permet de faire le lien et qui va se nourrir des observations et de la théorie pour, ensuite, soit retourner observer des phénomènes à travers des outils que j'ai pu développer, soit nourrir la théorie. Il y a vraiment des allers-retours constants entre ces différentes dimensions dans mon travail de recherche.
5.2 Les outils numérique du design
Le premier point que je voulais aborder, c'est donc l'analyse des outils numérique du design. C'est quelque chose qui est venu assez tard dans ma propre démarche, puisque j'ai d'abord commencé par observer la pratique des designers et c'est seulement dans un second temps que j'ai vraiment eu besoin, pour mieux comprendre ce que je faisais, d'aller creuser les outils tels qu'ils existent actuellement. Pour faire ça, je me suis beaucoup appuyée sur ce que G. Simondon appelle la "filiation technique", qui est l'idée que les objets ne sortent pas de nulle part mais qu'ils évoluent toujours à partir d'autres objets et artefacts. Par ailleurs, c'est une théorie qui est remise en question parfois mais qui me semble très intéressante pour étudier les outils du designer. La deuxième ligne de pensée qui m'a beaucoup aidée à réfléchir à cette analyse, est le travail de Lucy Suchman, qui est une anthropologue anglaise qui a été extrêmement fondatrice pour le domaine de l'interaction avec la machine. Elle expose dans son travail que chaque outil humain repose et matérialise une certaine conception sous-jacente de l'activité qu'il est conçu pour supporter. C'est pour moi assez crucial puisque ça signifie que, si ce que L. Suchman avance est vrai, alors tous les outils qui sont développés le sont à travers une sorte de modélisation de la pratique qu'on essaye de supporter, de faire tenir. Et donc, cela suppose aussi que l'analyse de ces outils permettrait de comprendre comment les créateurs en sont venus à faire ces choix-là, et comment ils influencent la pratique pour laquelle ils créent ces outils.
Quand on veut regarder et analyser les logiciels qui ont été développés pour les designers, encore une fois, plutôt les designers graphiques, on s'aperçoit qu'il y a trois types de logiciels et d'outils très différents : des outils qui ont été conçus dans une optique de recherche, donc par des chercheurs, des outils qui ont été créés par des designers et des outils qui ont été créés par l'industrie. Si on observe ces trois types d'outils d'un point de vue historique, je me concentrerai ici sur les premiers outils, ils répondent vraiment à des enjeux et des manières de faire extrêmement différentes. Les premiers types d'outils dont je voulais parler sont les premiers outils qui ont été conçus pour des designers et qui n'ont pas été faits par l'industrie ou par les designers eux-mêmes, ils ont été fait par des informaticiens. Ce qui est très intéressant quand on creuse dans l'histoire de l'informatique et des interfaces graphiques, c'est que la première interface graphique qui n'ai jamais été conçue, l'a été pour les designers (nous pouvons l'appeler designer, parce que dans la perspective anglaise se sont des designers, en français ce sont davantage des ingénieurs faisant de la CAO). Donc le premier outil qui a été conçu, qui s'appelait Sketchpad, a été conçu pour des designers. Ce qui est très intéressant quand on observe les tous premiers outils, quelques années plus tard, il y a par exemple cet outil qui a été conçu spécifiquement pour des designers tels que l'on en parle aujourd'hui. C'est un outil qui est dédié pour supporter le travail des animateurs graphiques. Or, lorsque l'on regarde comment ils ont travaillé pour créer ces outils, c'est que c'était un peu une excuse. Ils travaillaient pour des designers parce qu'ils pensaient que ces outils pouvaient être intéressants pour leurs pratiques mais il s'agissait surtout pour eux d'un moyen de développer ces interfaces graphiques qui à cette époque-là n'existaient pas. Par exemple, à travers Sketchpad, cette première interface graphique jamais créée, tous les premiers langages orientés objets ont aussi été développés, donc tout un type de langage de programmation. Ça a été un moment extrêmement important dans l'histoire de la programmation qui a été inventée au travers de cette conception-là. Ceci est vraiment visible dans l'exemple à l'écran, il y a vraiment une notion de ce que l'on appelle "réifier", c'est-à-dire transformer un dessin en un objet, sur lequel on puisse ensuite interagir, c'est quelque chose de très important dans l'informatique et qui a été développé dans ce cadre là. Ce qui est intéressant c'est de voir que ces outils étaient moins au service, c'est-à-dire tel qu'on le perçoit aujourd'hui en allant vraiment observer les besoins, et plus un prétexte pour travailler sur des outils, des interfaces graphiques naissantes qui n'existaient pas encore et même sur des langages de programmation.
Le deuxième exemple que je voulais présenter c'est un des tout premiers exemples, peut-être le premier exemple, d'une designer qui a créé ses propres outils, ici le terme outil est à prendre au sens très large. C'est une designer qui s'appelle Muriel Cooper, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui était à la base designer graphique au sein des MIT presse, une grande université aux États-Unis. Elle travaillait au début dans le service d'édition de l'école, puis elle a commencé à donner des cours à ses étudiants, et elle s'est progressivement intéressée à l'informatique. Elle a ensuite obtenu un poste en tant que chercheuse, c'était alors une des premières designers-chercheuses très tôt dans les années 70. Le MIT étant un haut lieu du développement de l'informatique, elle a eu accès très tôt aux machines qui étaient complètement inaccessibles aux praticiens dans les années 70-80, à un moment où il n'existait aucun logiciel, à part les prototypes de recherche évoqués précédemment, inaccessibles au grand public. Cooper a voulu se frotter à ces questions-là en tant que designer graphique. Ce qu'il faut préciser c'est que ce n'est jamais elle qui a développé et programmé, ça a toujours été ses étudiants, mais c'est elle qui a énormément poussé son laboratoire dans cette direction. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat de 10 années de travaux dans son laboratoire. Ce qui est vraiment important dans ce travail-là, c'est que tout de suite, non seulement elle a perçu le potentiel de l'informatique pour le design, mais pas seulement comme un moyen de soutenir une pratique déjà existante, mais elle a plutôt perçu à quel point l'informatique allait transformer radicalement la pratique du design. Et plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, elle a vraiment souhaité explorer ce que pourraient être des outils pour le designer dans un monde qui n'existait pas encore, parce que l'on était encore dans le monde du papier. Ce que vous voyez par exemple c'est un outil interactif de data visualisation pour visualiser des jeux de données, c'est alors assez incroyable de voir ça à cette époque. L'idée était très forte, en effet cette matière informatique et le fait que l'outil devenait interactif, transformait profondément le rôle du design. Donc concevoir ces outils pour les designers du futur ne pouvait pas, selon elle, aller sans complètement repenser le travail même du designer et ce que c'était d'être un designer. Par exemple, le fait que l'on n'était plus coincé dans un format prédéterminé et que, au contraire, ce sont les utilisateurs qui pouvaient aller eux-mêmes naviguer à leur propre rythme et de leur propre manière dans des ensembles de données. Pour elle, ceci transformait la perspective du designer puisque son rôle devenait moins la mise en forme de quelque chose de définitif. Il avait plutôt pour rôle de donner les moyens à l'utilisateur de naviguer dans un ensemble de données et de se créer ses propres chemins.
Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on donne aux designers des outils informatiques dans les mains, ils ne se contentent pas de créer des outils qui supportent leur pratique existante mais ils transforment radicalement ce qu'ils pensent être la pratique du design.
Un autre exemple très parlant, c'est l'exemple de deux typographes aux Pays-Bas qui ont créé cette typographie à travers la programmation dans les années 90, avec l'idée que chaque lettre serait toujours différente. Ils voulaient essayer de retrouver l'accident possible de la main. Alors ils ont programmé cette typographie pour faire en sorte que chaque fois que vous tapez une lettre, celle-ci sera toujours un petit peu différente. Ils essayaient, là aussi, de repenser ce que c'était une typographie à l'air de l'informatique au tout début quand il n'y avait pas encore d'outils de disponibles.
Puis le troisième type d'outils, celui que, nous designers, nous avons eu entre les mains à notre époque, ce sont les outils qui ont été développés par l'industrie. Là, les principes ont été radicalement différents.
C'est ce que nous allons voir à travers le logiciel Aldus, un des tout premiers logiciels de mise en page, qui a été créé par Paul Brainerd. Il dit à ce sujet « l'essentiel de l'interface et la manière dont-il fonctionne, ils viennent de ma propre expérience à avoir fait du maquettage avec un cutter ».
Ce qui est intéressant ici, c'est que les outils pour l'industrie n'ont pas du tout été pensé comme ça a pu être le cas pour les designers qui ont tenté de se créer leurs propres outils, c'est-à-dire comme quelque chose qui allait transformer la pratique. Au contraire, pour pouvoir faire accepter à des entreprises et des studios de design des outils avec lesquels ils n'étaient pas familiers, ils ont alors essayé de reproduire, au plus proche, les pratiques déjà existantes. Brainerd s'est inspiré de sa manière de travailler au quotidien, quand lui-même était graphiste. Alors, il n'y a pas eu une réflexion sur ce que l'informatique pouvait potentiellement transformer mais, au contraire, il a essayé de se coller à l'expérience du design telle qu'elle se faisait. C'est particulièrement intéressant pour moi de voir que ce sont des choses qui ont émergé dans les années 80 et que l'on retrouve aujourd'hui malgré le fait que tout l'environnement autour a complètement été transformé.
Un exemple très concret, c'est la notion de « past up », en effet avant que l'on ait des outils informatiques et que l'on puisse déplacer des choses sur un écran on devait couper les images. Les graphistes et metteurs en pages venaient découper les images, les titres préalablement commandés avec la bonne taille de typo ou alors le corps de texte, et ils venaient les agencer sur la page pour qu'ils puissent être reproduits. On retrouve encore des traces dans la manière dont fonctionne le logiciel Indesign puisque vous pouvez avoir le texte que vous allez ensuite pouvoir venir couper dans des blocs que vous allez pouvoir positionner. Et donc quand vous allez changer la taille d\'un bloc, le texte va se réagencer. Cette manière de fonctionner est extrêmement similaire à ce qui se faisait à l'époque.
Un autre exemple, c'est qu'avant, pour commencer à travailler en tant que graphiste, il fallait d'abord choisir son format puisqu'il dictait tout le travail de la mise en page d'un livre. On retrouve cette chose-là sur Indesign ou sur beaucoup d'autres outils, la première chose qui est demandée c'est de sélectionner à quel format on veut travailler. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, en 2021, en tant que designer, on ne commence pas du tout avec un format puisque l'on va concevoir pour beaucoup de tailles différentes, par exemple des tailles d'écrans différents, ou encore concevoir pour le print et pour le numérique. Alors, cette question pourrait largement être repensée mais nous sommes tributaires de cet héritage qui a été déposé dans ces outils et qui tentait de recréer une pratique qui n'existe plus aujourd'hui.
Ces exemples ont permis de voir comment on peut essayer de comprendre les outils en les analysant.
Je vais maintenant essayer de montrer ce qui se passe concrètement quand les designers travaillent avec les outils actuels, ce qui était ma première démarche en tant que chercheuse.
5.3 Les outils actuels des designers, analyses et recherches
Mon tout premier projet a été de réfléchir à l'interaction avec la couleur parce que c'était peut-être l'élément graphique à la fois prépondérant et extrêmement caché dans les pratiques. Chaque fois que j'en parlais avec mes collègues c'était un peu toujours la même chose qui revenait : " moi la couleur je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet". Ils n'étaient pas nécessairement conscients de la manière dont eux-mêmes travaillaient avec la couleur. Mais j'ai aussi choisi ce sujet aussi parce qu'il était très emblématique de ce que je disais au début, on avait une uniformisation des outils sur le temps long. C'est-à-dire que si on regarde les sélecteurs de couleurs, les premiers qui sont apparus dans les années 90, non seulement ils ont très peu évolué dans le temps, voire pas du tout, dans leurs fonctionnalités. Autre chose qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est le fait que ce soit pour les logiciels destinés au grand public, tel que Word, ou que ce soit pour les logiciels destinés aux professionnels, on retrouvait exactement les mêmes types d'interactions, là où l'on pourrait se dire qu'il y a des besoins qui sont différents. Ceci a donc été le point de départ pour mener une série d'entretiens avec des artistes et des designers pour essayer de comprendre comment ils travaillaient la couleur, comment ils utilisaient leurs outils au quotidien. Ce que l'on a tiré avec ma collègue Rita Jalal, c'est tout un ensemble d'histoires de pratiques de couleurs qui ont révélé la richesse et la diversité de ces pratiques et à quel point elles ne se résumaient pas à un outil. En analysant ces histoires on a pu percevoir qu'il y avait au moins 5 grands types de manipulations de la couleur qu'on pouvait identifier pour essayer de montrer qu'ils ne correspondaient pas à ce que proposaient les outils.
Je vais donc vous en présenter 3. Le premier type de manipulation de la couleur c'était une réflexion sur la couleur, non pas en terme de couleur individuelle telle qu'elle peut être travaillée dans un sélecteur de couleur, mais en terme de palette. En effet, on travaille très rarement une couleur de façon isolée. C'est ce que l'on a retrouvé de manière extrêmement forte chez les designers avec par exemple une designer qui travaille ses palettes à travers des photos. En prenant différents objets et créant des compositions, elle réfléchit à différentes couleurs et comment elles dialoguent entre elles.
Un deuxième aspect que l'on a trouvé extrêmement fort, et là aussi très peu supporté par les outils actuels, c'était comment les designers tentaient à la fois de capturer et réutiliser l'historique et les étapes de conception de la couleur. Cet aspect comprenait également la manière dont ils essayaient de conserver le contexte de la couleur aussi. Par exemple, un designer créait autour de son document Illustrator ses propres palettes avec des petits carrés de couleurs, ce qui lui permettait de les conserver en contexte. De cette manière, elle pouvait toujours retrouver ses palettes qu'elle avait testées.
Le troisième aspect, c'est l'utilisation de la couleur non pas comme un élément en soi mais comme un moyen de révéler le processus de conception. C'est quelque chose que l'on a pu voir dans le travail d'une designer, où elle faisait chauffer le métal et selon la température ça donnait une couleur différente au matériau. Elle travaillait la couleur non pas pour la couleur mais vraiment comme un moyen de révéler le temps passé à faire cette chaise. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est supporté par les outils actuels des designers.
J'ai poursuivi ce travail sur des éléments très microscopiques du travail de designer. Le second élément sur lequel on s'est attardé c'est la question de l'alignement et de la distribution des éléments. Là aussi, on retrouvait un peu le même constat. En effet, les toutes premières commandes d'alignement et de distribution, par exemple celle de MacDraft en 1984 et celle que l'on retrouve encore aujourd'hui sur Illustrator fonctionnent de la même façon. Là aussi, il y avait un besoin d'aller identifier les écarts qui peuvent exister entre ces outils et les pratiques, on a donc conduit une série d'entretiens avec une autre collègue Marianela Ciolfi Felice. On a tiré trois aspects qui manquent dans les commandes telles qu'elles existent aujourd'hui, qui sont pourtant nécessaires dans le travail de designer. Le premier c'était la notion de persistance, puisque ce qui est gênant quand on utilise des commandes, c'est qu'une fois que l'on a aligné des éléments, si on veut en amener d'autres, il faut tout réaligner. Il n'y a pas de persistance de ces choses-là, à chaque fois il faut tout remettre en place.
Le deuxième, c'était la notion de contrôle sur cet algorithme, puisque quand vous alignez des éléments de tailles différentes ça ne fonctionne pas et donc il va falloir venir manuellement essayer de régler les choses parce que l'algorithme, derrière ses commandes, ne montre pas la manière dont il fonctionne. En somme, il cache son fonctionnement sous prétexte de simplifier les choses, ce qui oblige à faire un travail à la main, ce qui fait que lorsque l'on va ramener un nouvel élément, il va falloir tout réaligner.
Le dernier aspect est un vrai besoin de généraliser les outils parce qu'aujourd'hui ils étaient vraiment limités à des questions de verticalité ou d'horizontalité alors qu'il y a besoin d'alignements beaucoup plus complexes sur des formes émergentes.
Le dernier exemple que je voulais montrer concerne des questions de mise en page, en essayant de s'élever à un niveau supérieur et être moins basé sur un outil en particulier et plus sur une pratique globale du design.
On s'est posé cette question ; comment les designers mettent-ils en page leurs documents et comment travaillent-ils avec leurs outils actuellement ? On a utilisé le même procédé, une série d'entretiens spécifiques avec des graphistes sur leur pratique existante. On en a tiré tout un ensemble d'histoires qui montraient une richesse dans les pratiques. Ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est que quand on lit des livres sur la mise en page ou que quand on écoute des designers en parler, un outil qui va revenir très souvent qui est assez fondateur dans les outils numériques : la grille. Ce qui était frappant c'est que dans les designers que l'on a interrogés, certains utilisaient des grilles mais beaucoup de designers ne s'en contentent pas et travaillaient de manière beaucoup plus complexe ou beaucoup plus riche. C'était là encore quelque chose qui n'était pas supporté par les outils actuels. Un exemple très concret c'était par exemple cette designer qui a décidé de faire une mise en page complètement basée sur le nombre 42. Elle avait une grille qui fonctionnait sur des multiples de 42 mais pas seulement, c'était aussi des multiples de 42 qui étaient utilisés pour les tailles de caractère, pour les tailles de filets et pour les couleurs. L'ensemble était basé sur le nombre 42, or il n'y en avait aucune qui permettait de le prendre en compte dans les outils. Alors, si elle souhaitait changer de nombre, il fallait qu'elle recommence à zéro.
On a analysé tout ce travail en essayant de comprendre le travail de mise en page des graphistes sous la forme de ce qu'on a appelé des substrats graphiques. C'est une notion que l'on a essayé de mettre en place pour essayer de montrer la manière dont les graphistes fonctionnaient lorsqu'ils mettaient en page en prenant des choses qui soient et/ou des concepts qui viennent du contenu ou du contexte et qui se servent de ces substrats graphiques pour mettre en place des choses à la fois spatialement et à la fois de manière temporelle. Prenons très concrètement l'exemple de la façon dont la mise en page évolue spatialement et temporellement. On peut penser au travail de Frédéric Teschner. Celui-ci expliquait que son travail de mise en page sur cette série de poster n'est pas uniquement sur un poster mais elle se joue dans une question de rythme dans le temps long. Il va y avoir certains éléments qui vont être récurrents et toujours présents, il va y avoir une « mascotte », une petite planète qui va être toujours présente mais qui va à chaque fois se modifier de manière cohérente tout du long en racontant une histoire sur le temps long. Il y avait également des éléments qui ne revenaient jamais, il y avait vraiment une réflexion, non pas sur le poster individuellement mais dans la série, qui était là encore quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte par les outils actuels. Il y avait aussi une réflexion à partir du contenu, là c'était des gens qui travaillent avec la programmation, des gens comme Raphaël Bastide par exemple, il crée des mises en page qui fonctionnent en fonction de la longueur du titre d'un article. Selon la longueur du titre vous allez avoir des règles de mise en page différentes et ça il peut le faire parce qu'il programme lui-même. Ces choses-là ne pourraient pas être mises en œuvre de manière efficace avec des outils numériques existants.
Le dernier aspect c'est la notion de contexte qui était prise en compte par les designers avec la volonté de prendre en compte, notamment, la possibilité pour les utilisateurs d'aller visualiser leur travail en changeant l'échelle de l'impression, que ça soit sur un grand ou petit format. Il y avait alors des règles de mise en page qui étaient développées différemment. Là encore, le but c'était de prendre en compte le contexte mais ça n'aurait pas été possible de le faire avec les outils actuels. Il y avait donc un recours à la programmation pour faire ces choses-là. C'est ce que l'on a essayé de montrer, dès que l'on sortait des cadres traditionnels les designers avaient besoin de faire appel à la programmation pour pouvoir mettre en œuvre leur mise en page telle qu'ils le souhaitaient. Il y avait alors un vrai écart entre les outils actuels et la pratique des designers.Toute cette analyse pour essayer de montrer que derrière les outils actuels il y a plusieurs mythes, il me semble, et je vais en présenter deux qui sont les mythes principaux.
5.4 Les mythes derrière les outils actuels
Le premier mythe renvoie à la notion d'hylémorphisme, avec cette idée, développée par Tim Ingold, qui serait l'idée que les designers auraient déjà en tête ce qu'ils veulent réaliser et que les outils seraient uniquement là pour leur permettre de mettre en forme, de passer de l'idée à la pratique. C'est évidemment une idée que Tim Ingold rejette et il me semble que les exemples montrés montrent que ce n'est pas du tout la manière dont les designers fonctionnent. Par contre, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans la manière dont les outils ont été créés. Si on regarde par exemple le fameux sélecteur de couleur, dont je vous ai déjà un peu parlé, si on essaye de comprendre quels ont été les choix faits derrière ce sélecteur, en fait c'est un outil qui est extrêmement efficace si on pense que les designers ont déjà en tête exactement la couleur qu'ils veulent sélectionner, parce qu'en deux clics on a accès à l'ensemble des couleurs. Donc, si on pense que les designers connaissent déjà la couleur qu'ils souhaitent avoir, l'outil fonctionne, or, parmi les exemples que j'ai montrés, il me semble que l'on voit très bien que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a beaucoup plus d'étapes dans le travail des designers et il y a une vraie réflexion sur la pratique dans l'action qui permet au designer d'aboutir à une couleur sans l'avoir directement en tête. De la même manière, on peut faire la même analyse des commandes d\'alignement et de distribution, où c'est extrêmement rapide, vous sélectionnez vos objets, vous faites un clic et c'est aligné. Donc, si l'idée c'est de dire que les designers savent exactement ce qu'ils ont en tête, alors oui, ça va marcher. Or, encore une fois, la manière dont fonctionnent les designers est beaucoup plus complexe et du coup ces outils ne répondent pas à la manière dont les designers fonctionnent.
Le deuxième mythe qui est peut-être encore plus pernicieux et que l'on retrouve de manière beaucoup plus globale dans l'antichambre du design, c'est-à-dire que ça ne touche pas uniquement les concepteurs d'outils mais également la pratique du design en particulier la pratique du design appliquée au numérique, touche à la notion d'invisibilité. C'est cette idée, qui découle de l'hylémorphisme il me semble, que les outils sont en quelque sorte un mal nécessaire mais qui ne fait pas réellement partie du travail du designer. C'est explicité de manière très forte dans cette publicité pour l'une des toutes premières versions d'Illustrator, la personne qui parle dans la publicité dit que les outils pour les designers ont besoin d'énormément de compétences pour être utilisé, y compris dans les mains d'un pro et qu'ils prennent trop de temps, et ce temps pourrait être utilisé à la place pour concevoir, pour faire du design. Comme si le temps qu'on passe à utiliser des outils n'est pas un moment de design et que donc le but des outils ce serait de devenir invisibles, de prendre le moins de temps possible et d'être le plus restreint possible. C'est une idée extrêmement forte qui explique pourquoi on va toujours aller vers le moins d'interactions possible, le moins d'actions possible, le moins de réflexion possible dans les outils en essayant d'être toujours le plus rapide possible, bien que ce ne soit pas du tout la manière dont les designers fonctionnent, ce que j'ai essayé de développer dans les exemples plus hauts.
5.5 Propositions d'outils
Pour terminer, à partir de ce travail, l'idée a été aussi de ne pas faire uniquement ce travail d'analyse mais aussi de proposer des outils. C'est à travers le développement de ces outils que cette réflexion sur les mythes a aussi pu vraiment émerger. Par exemple, en terme d'outils de couleurs la dimension assez cruciale a été de ne plus penser un outil unique mais de penser, au contraire, une multitude d'outils parce qu'il n'y a pas une seule pratique de la couleur mais il y en a une multiplicité qui se concentre sur des aspects différents. Donc il ne faut plus penser à quelque chose qui pourrait répondre à tout mais au contraire qui peut, peut-être, supporter la pratique d'un seul designer parce que ça peut tout à fait venir nourrir la pratique d'autres. La manière dont j'ai fonctionné a toujours été de me baser sur ces histoires de designers, que j'ai pu récolter dans ces interviews, pour ensuite les réinvestir, et parfois de manière extrêmement littérale dans les outils. Par exemple, un outil que j'ai pu développer dans ce contexte, c'était un outil dédié à la question de la palette où l'objectif ça a été de penser la couleur, non pas comme ce petit carré perdu au milieu des autres, mais au contraire penser la couleur dans son contexte avec vraiment la notion de composition qui soit très forte et puis la possibilité aussi d'interagir avec une palette entière pour pouvoir conserver des relations existantes entre les couleurs, c'était des choses dont les designers avaient parlé et que j'ai juste réinvestie dans ce travail. Ce qui est intéressant dans ce travail de conception, c'est que derrière j'ai pu retourner voir des designers et voir comment ils s'approprient ces outils. L'un d'entre eux m'a dit que cet outil pourrait être intéressant pour lui pour facilement expérimenter des masses colorées qui permettent de faire des mock-ups de site internet, ce qui n'était pas du tout ce que moi j'avais envisagé derrière cet outil. Alors, c'était intéressant de voir que dès que l'on propose des choses, les outils sont toujours réinterprétés, réadaptés avec des envies complètement différentes.
Le deuxième outil était basé sur la notion d'historique, c'est un outil qui s'appelait « color partner», il essayait de prendre le contre-pied de l'idée que les outils devraient être invisibles, et au contraire qu'un outil peut être force de proposition ou être vraiment dans une interaction avec l'utilisateur. L'outil va vous proposer des couleurs qui apparaissent sous la forme de bulles avec une interaction qui est que plus vous allez être proche de la bulle et plus les couleurs qui vont vous être proposées vont être proche de la couleur initiale et plus vous allez vous éloigner et plus les couleurs vont être différentes. Il y avait aussi un aspect qui était que plus vous utilisez une couleur plus elle va grossir et prendre de l'espace. En revanche, si vous n'utilisez pas une couleur elle va progressivement être réduite et disparaître, sur le long terme, cela permet de rendre visibles les couleurs que vous avez beaucoup utilisées ou à partir desquels vous travaillez beaucoup ainsi que les espaces de couleurs avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler, à la manière dont la palette d'un peintre reflète cette histoire. Ce qui était intéressant de voir quand on est allé tester ces outils c'était comment d'un outil qui ne permet pas au designer lui-même de choisir une couleur, qui pourrait paraître impersonnel, un designer nous a dit que, pour lui, au contraire, la palette lui semblait extrêmement personnelle et qu'il n'aimerait pas partager les couleurs qu'il a pu générer. C'était assez surprenant pour nous d'observer ça.
Le dernier outil sur la couleur était basé sur la notion de processus, c'était un outil de couleur non pas pour sélectionner la couleur mais pour la travailler comme quelque chose qui puisse révéler un processus. On a donc choisi le processus d'écriture. Chaque fois que vous allez taper une lettre, l'outil va vous mettre un petit transparent coloré derrière et à chaque fois que vous effacez, étant donné que c'est translucide, ça va venir s'additionner et donc vous allez pouvoir voir les paragraphes sur lesquels vous avez passé le plus de temps ou les typos que vous avez pu tester. La couleur évolue en fonction du temps donc vous allez pouvoir voir quand est-ce que chaque paragraphe a été rédigé. Après avoir testé cet outil, c'était amusant de voir comment certains designers ont pu prendre conscience de leur processus. Par exemple, une des participantes nous a dit que chaque fois qu'elle faisait une typo, plutôt que d'effacer juste une lettre, elle avait tendance à effacer le mot en entier. On a donc développé des outils pour essayer de répondre à la question de la distribution et de l'alignement, ensuite on a développé des outils pour la mise en page.
La conclusion pour moi de ce travail a été de voir que, pour l'instant, la manière dont on réfléchit les outils pour le design c'est vraiment comme s'il y avait deux pôles qui ne se parlaient pas. À la fois il y a les interfaces graphiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui n'intéressent plus grand monde pour être honnête, on est un petit peu coincé. Et au contraire, il y a une vraie exploration foisonnante sur des questions de programmation où des designers veulent réinvestir ces champs-là, mais ce sont des champs qui ne se parlent que très peu. Or, à travers les outils que j'ai essayé de développer et les notions qu'on a mises en œuvre j'ai essayé de montrer que ce n'était pas vrai qu'il n'y avait rien entre les deux, il y a quand même quelques outils qui se positionnent un petit peu. Mais pour l'instant il y a très peu de personnes qui se positionnent entre. J'avais envie de conclure sur le fait que c'est peut-être cet espace entre ce gradient qui peut exister entre ces deux aspects qui me semblent vraiment crucial à aller réinvestir aujourd'hui pour ne pas rester sur l'idée que les interfaces graphiques sont dépassées et que parce que, pour l'instant, elles sont aliénantes on ne peut rien en faire. Je ne pense pas que ce soit le cas et au contraire, si la programmation est extrêmement riche, et moi-même j'y suis très attachée, je pense qu'il y a beaucoup de choses que la programmation ne peut pas faire et donc il y a vraiment nécessité d'investir ce champ-là.
Pour conclure, je voulais citer un graphiste et chercheur néerlandais qui expliquait que si le WYSIWYG (What You See Is What You Get, c'est-à-dire l'idée d'avoir des interfaces graphiques qui reflètent exactement ce que vous faites, ce que vous faites à l'écran correspond à ce que vous allez imprimer donc Indesign par exemple) était un peu moins tabou dans la culture hacker dans le milieu des designers qui s'intéressent aux outils alors peut-être que des solutions intéressantes qui croiseraient texte brute et mise en forme graphique pourraient émerger. Pour l'instant on n'y est pas encore mais j'invite toutes les personnes qui s'y intéressent à y aller.
Je voulais terminer ma présentation en remerciant tous mes collaborateurs, parce que ça n'a vraiment pas été un travail individuel et au contraire il repose beaucoup sur mes collègues et sur tous les designers qui ont participé aux interviews ainsi que testé les outils.
6. Discussion
Laura Tchatat
C'est juste la curiosité par rapport au chiffre 42, est-ce qu'il y a un rapport avec Douglas Adam et tout l'univers geek ou c'est un hasard ?
Nolwenn Maudet
Non bien sûr c'était lié, c'était son choix comme elle devait faire une mise en page pour illustrer ce livre, évidemment elle a décidé de baser son livre sur ce nombre-là.
Émile De Visscher
Merci beaucoup pour cette présentation, c'était passionnant. J'avais une question à propos d'outils et de maîtrise et de la différence entre les deux, finalement quand tu rentres dans des systèmes de programmation, ce sont les algorithmes qui vont potentiellement décider de certaines formes, est-ce qu'on ne passe pas dans le domaine de la machine numérique qui, de manière autonome, va faire des propositions qu'il s'agit de valider ou d'invalider mais ce n'est plus l'outil c'est plutôt une palette qu'on prend en main. Est-ce qu'il y a aussi un moment où certains disent qu'ils veulent garder la main et pas entrer dans le domaine de l'automation et à l'inverse d'autres disent que l'automation peut servir à être plus créatif.
Nolwenn Maudet
Tout à fait, c'est une grande question, je n'ai pas eu le temps de questionner ce champ-là dans ma présentation d'aujourd'hui, mais effectivement c'est une question qui m'intéresse énormément, celle de l'automatisation, là on a des réactions très diverses de la part des designers. Moi si je me positionne plus sur l'analyse de ces outils-là, il me semble qu'ils tombent toujours dans les mêmes travers, c'est-à-dire qu'ils pensent toujours que le travail avec les outils n'est pas un temps passé à faire du design et que si on automatisait les choses alors les designers auraient plus de temps pour faire leur travail de designer et ce qui est, à mon avis, un non-sens complet. Il y a alors à repositionner ces questions ou ces mythes sur les outils qui prétendent aller vers l'automatisation. Effectivement, le fait de passer à des machines transforme la relation aux outils et pourtant, il me semble, repose sur ces mêmes principes derrière.
Sophie Fétro
Est-ce que, Nolwenn, tu as aussi étudié des programmes ou des logiciels libres ? Qui ne sont pas que des logiciels propriétaires, pour voir la différence, parce que c'est vrai que l'on est surtout sur Adobe, sur les logiciels courants des graphistes, mais est-ce qu'il y a des différences notoires entre le libre et le non libre ? Parce que moi ce que je vois c'est qu'il y a dans les logiciels libres beaucoup de copies pour que les utilisateurs ne soient pas perdus et retrouvent les mêmes outils que sur Adobe, et en même temps quand on creuse il y a quand même des petites différences.
Nolwenn Maudet
Oui, c'est une très bonne question. Je ne me suis pas du tout penchée sur les outils du libre pour la raison que tu as cité, à la fois parce qu'ils étaient moins utilisés et puis surtout parce que dans les outils correspondants dans le libre étaient beaucoup dans la copie jusqu'à assez récemment. Mais c'est vraiment quelque chose qui a bougé il me semble ces dernières années, il y a vraiment eu une prise de conscience assez forte des designers et des créateurs de ces outils à propos des faiblesses flagrantes dans les outils actuels propriétaire, il y avait moyen avec les outils libres de venir réinterroger les choses. Il me semble que ça ne s'est pas passé, parce que les designers qui s'intéressent à ces questions de s'attacher à sortir des outils traditionnels se sont intéressés à la programmation parce que c'est de la programmation qu'est né le libre et donc ils ont souvent sauté directement des logiciels propriétaires à la programmation en faisant l'impasse sur ces outils libres. Il y a quand même des designers qui essaient d'utiliser ces outils libres, mais je connais beaucoup plus de designers qui essayent de se créer leurs propres outils avec la programmation parce qu'ils ne veulent pas être dépendants de ces outils. Je pense qu'il y a une vraie nécessité d'aller creuser ces outils, ce que moi je n'ai pas encore fait et je pense que ce serait peut-être le bon moment parce qu'il y a eu des prises de conscience vraiment fortes ces dernières années.
Sophie Fétro
Je suis par exemple passée sur Inkscape, puis sur Gimp, etc. Ça m'a pris environ un an pour opérer la transition, ce qui était long parce que j'ai appris Adobe depuis mes 14 ans donc ça fait très longtemps ! J'étais vraiment dans des automatismes très grands et c'est très long de se défaire de ces automatismes-là. Par contre dans Inkscape j'ai trouvé des outils qui étaient spécifiques à ce logiciel et que je n'avais pas dans Adobe comme par exemple la création de clones pour faire des copies. Une fois que l'on comprend la logique, le système devient très opérant, donc ça c'est super, je pense que c'est vraiment un espace d'exploration assez intéressant d'un point de vue de la recherche.
Nolwenn Maudet
Oui complètement, surtout que cette notion de clone renvoie à Sketchpad (dont je n'ai pas parlé dans cette présentation), qui avait déjà cette notion de clone, or on l'a complètement perdu dans les outils "mainstream" et du coup je pense que parce que les développeurs du libre ont cette culture de l'informatique, ils ont plutôt ramené ces concepts-là qui n'existaient pas dans les logiciels du type Adobe. J'ai vu apparaître le clone dans des outils type sketch et autres, cette notion s'est effectivement beaucoup développée ces dernières années.
Catherine Chomarat-Ruiz
C'est évidemment un peu frustrant, mais il faut suspendre la séance... Merci tous les trois pour tout ce que vous avez montré, exposé, pour les cas que vous avez analysés, c'est tout à fait judicieux et riche.
Il y a une chose qui m'amuse, c'est que finalement je vous ai plutôt invités parce que je pensais que vous poseriez, à travers vos analyses, la question d'une éthique du design et, c'est peut-être un fil qui court entre vous, est apparue une éthique de la profession à travers ces machines un peu étranges chez Sophie, à travers ce retravail sur les matériaux et ce que signifie monter des process via des machines chez Émile, et à travers cette idée de l'écart entre l'outil et la pratique que l'on a de l'outil, voire même le détournement et l'enrichissement que l'on peut faire de l'outil chez Nolwenn. Donc, non pas une éthique comme horizon, mais comme une éthique à l'intérieur même d'une pratique et de la profession. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le temps imparti arrive à son terme. Merci encore !
Crédits et légendes
Figure 1. Synthèse graphique 3 © Lucy Doherty
-
https://arianeprin.com/object/water-cups-fountain/, consulté le 4 juillet 2021. ↩
-
Georges Kayas, « MACHINES SIMPLES », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 19 janvier 2021 :
URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/machines-simples/ ↩ -
https://arianeprin.com/object/water-cups-fountain/, consulté le 4 juillet 2021. ↩
-
Jean-Pierre Séris, Machine et communication. Du théâtre des machines à la mécanique industrielle, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1987, p. 17. ↩
-
Herbert H. Knecht, « Le fonctionnement de la science baroque : le rationnel et le merveilleux », Baroque [En ligne], 12 | 1987, mis en ligne le 30 juillet 2013, consulté le 25 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/baroque/578 ; DOI : https://doi.org/10.4000/baroque.578 ↩
-
Anne Sauvagnargues, « Le goût baroque comme détermination d'un style : Wölfflin, Deleuze », Appareil [En ligne], 9 | 2012, mis en ligne le 02 juillet 2012, consulté le 04 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/appareil/1413 ; DOI : https://doi.org/10.4000/appareil.1413. ↩
-
Ibidem. ↩
-
Frank Lloyd Wright, In the Cause of Architecture : The architect and the machine, The Architectural Record, May 1927. (Traduction S. Fétro). ↩
-
Siegfried Giedion, Mechanization Takes Command, New York : Oxford University Press Inc., 1948. La mécanisation au pouvoir, Paris : centre Pompidou/CCI, 1980, pour la traduction française. ↩
-
Lewis Mumford, Le mythe de la machine. Technique et développement humain (1966), Paris : L\'Encyclopédie des Nuisances, 2019. ↩
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/RepRap, consulté le 4 juillet 2021. ↩
-
C-FABRIEK. Les dix anciens élèves du Master DAE 2011 ont présenté la C-Fabriek pendant la semaine du design néerlandais en 2012. La C-Fabriek est une exposition montée par de jeunes designers qui reprennent le contrôle sur leurs créations. Dans une usine vide à Eindhoven, ils créent leurs propres lignes de production, des machines, des outils et des produits, rétablissant ainsi une relation avec le public. ↩
-
https://mischertraxler.com/projects/the-idea-of-a-tree-process/, consulté le 4 juillet 2021. ↩